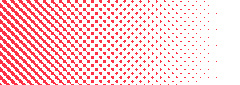Diderot, Balzac, Michon : la création par la destruction
1Dans Le Musée impossible. La collection des œuvres d’art qu’on ne peut plus voir, Céline Delavaux pose à juste titre que l’histoire de l’art est « peuplée de fantômes dont certains sont paradoxalement plus célèbres et plus précieux que bien des tableaux qui peuplent sereinement et discrètement nos musées »2. Son livre dresse le catalogue d’une quarantaine d’œuvres qui ont disparu par sous l’effet de causes diverses : intempéries, guerres, catastrophes naturelles, vols, incendies…, nous laissant héritiers d’un savoir tronqué. Un cas de figure particulier nous intéressera ici : celui de tableaux détruits par l’artiste lui-même, et recréés ensuite dans une œuvre littéraire. Ainsi de Watteau, qui aurait brûlé le pan licencieux de son œuvre selon une légende qui persiste encore aujourd’hui, et dont s’empare Pierre Michon dans son récit Je veux me divertir3. La nouvelle restée célèbre de Balzac, Le Chef-d’œuvre inconnu, forme également un récit littéraire de tableaux-fantômes : ceux d’un peintre fictif, Frenhofer, dont les dernières lignes relatent « qu’il était mort dans la nuit, après avoir brûlé ses toiles. » (p. 60)4 Tableaux-fantômes vrais et tableaux-fantômes fictifs brûlés par l’artiste, que la littérature s’attache à recréer : il ne manque à ces deux catégories que celle des tableaux-fantômes possibles, dont Diderot nous fournit un exemple, et qui formeront le point de départ de notre analyse.
2Pour ceux qui sont curieux de voir à quoi peut ressembler un tableau-fantôme possible, nous les invitons à démarrer l’enquête au deuxième étage de l’aile Sully au du musée du Louvre où, après avoir parcouru les siècles à rebours jusqu’au fond de la galerie Est, ils pourront gagner la salle 51, dite « salle Greuze ». Sur le mur gauche, au milieu des œuvres du peintre, ils verront un tableau représentant Septime Sévère reprochant à Caracalla son fils d’avoir attenté à sa vie dans les défilés d’Écosse. C’est le morceau de réception de l’artiste, celui qu’il présenta en 1769 pour se faire élire à l’Académie. Si le tableau donne un sujet d’histoire, c’est toutefois comme peintre de genre que Greuze entra à l’Académie. En effet, l’assemblée des académiciens jugea sévèrement son Septime Sévère, et c’est pour l’excellence de ses productions dans la catégorie des œuvres de genre qu’ils admirent Greuze dans l’institution. Au temps où la hiérarchie des genres était encore en vigueur, suivant laquelle la peinture de genre se trouvait tout en bas de l’échelle, cette décision fut ressentie par Greuze comme un déshonneur public.
3Si l’on considère aujourd’hui ce tableau comme l’un des premiers exemples du néoclassicisme, il retient ici notre intérêt pour une raison d’ordre poétique. En effet, son caractère d’œuvre-fantôme possible est une suggestion de Diderot, critique d’art à ses heures, lorsqu’il relate dans son Salon de 1769 l’épisode de la réception ratée de Greuze à l’Académie dans les termes suivants :
Apprenant que l’Académie ne le reçoit « que » comme peintre de genre Greuze déchu de son espérance, perdit la tête, s’amusa comme un enfant à soutenir l’excellence de son tableau, et l’on vit le moment où Lagrenée tirait son crayon de sa poche afin de lui marquer sur sa toile même les incorrections de ses figures.
Qu’aurait fait un autre ? me direz-vous. Un autre, moi par exemple, aurait tiré son couteau de sa poche et aurait mis le tableau en pièces ; ensuite il aurait passé la bordure autour de son cou, dit à l’Académie qu’il ne voulait être ni peintre de genre ni peintre d’histoire ; rentré chez lui pour y encadrer les têtes merveilleuses de Papinien et du sénateur qu’il aurait épargnées au milieu de la destruction du reste, et laissé l’Académie confondue et déshonorée ; oui, mon ami, déshonorée ; car le tableau de Greuze avant d’être présenté passait pour un chef-d’œuvre, préjugé que les débris auraient perpétué à jamais, débris que le premier amateur aurait acquis au poids de l’or5.
4Des poignées d’or pour des débris, et surtout, la renommée : combien d’œuvres auraient pu être des chefs-d’œuvre si leur disparition avait suivi leur création ? La thèse de Diderot, que nous prendrons à notre compte ici, consiste à affirmer que la destruction est foncièrement créatrice. Cette proposition va à l’encontre de l’idée répandue selon laquelle la création et la destruction sont antinomiques, et que les œuvres doivent être conservées en fonction de leur valeur et de leur dignité. Cette conviction profonde de Diderot, qu’il exprime ailleurs encore dans ses Salons (comme lorsqu’il imagine le groupe sculpté de Pygmalion par Falconet plus parfait encore s’il avait été détruit par endroits6), est aujourd’hui illustrée par bon nombre d’œuvres d’art moderne. Par exemple, La Maison de Jean-Pierre Raynaud, que Céline Delavaux mentionne dans Le Musée impossible, est une construction faite entièrement en céramique blanche et détruite par l’artiste au bout de vingt-trois ans de travail de construction, dont il fait exposer les restes dans le au musée d’art contemporain à Bordeaux7.
5La thèse de la création par la destruction telle que l’énonce Diderot devant Greuze sous-entend au moins deux choses. Premièrement, il y a de multiples façons de détruire des œuvres, mais on peut voir une nette différence entre les œuvres disparues par l’effet du temps ou du hasard et celles qui doivent leur effacement à une geste de décision, qui se veut un geste foncièrement artistique, impliquant un tri, aussi rapide soit-il. Ce tri suppose à la fois un œil critique, qui discerne les parties signifiantes, et une main d’artiste, celle qui sauve ces parties, ces « débris » qui valent de l’or, tout en saccageant le reste. Le choix de l’œil amène donc la découpe de la main, pour séparer, rejeter, repousser dans l’ombre de l’oubli ce qui n’est pas jugé digne d’être sauvé.
6Deuxièmement, la disparition de l’œuvre peut aller de l’effacement complet à la destruction partielle ; les débris devenant des bribes : des restes de l’œuvre qui échappent à leur auteur pour entamer une nouvelle existence dans le commentaire. Les mots des critiques façonnent alors les contours des œuvres, les transforment pour les ré-encadrer et leur conférer une nouvelle dignité. C’est le « supplément imaginatif » qui naît sur les restes, dans le souvenir des œuvres, dont nous parle Judith Schlanger dans la Présence des œuvres perdues disparues8. Les débris perpétuent les préjugés, dit Diderot : dans cette recréation par la destruction, nous verrons que la perpétuité de l’œuvre est une affaire d’échos et de résonance, par le pouvoir de hantise de l’œuvre sur les lecteurs.
7Les cas des œuvres détruites par la main de l’artiste et qui sont ensuite littérairement recréées infléchissent de manière intéressante la thèse de la création par la destruction de Diderot, dans la mesure où ils permettent d’éclairer une singulière destruction de l’œuvre en amont et en aval de l’œuvre. En effet, en amont de la création de l’œuvre, il s’opère une destruction par le tri, conduite par le choix de l’œil et par les incisions de la main, pour extraire l’œuvre d’un monde de fantômes perçu par l’artiste (1). En aval s’opère ensuite une recréation de l’œuvre par le commentaire, qui achève l’œuvre en chef-d’œuvre (2) en s’emparant des débris, traces ou restes de l’œuvre pour la transformer à son tour en fantôme pour le lecteur ou le spectateur (3).
1. Donner corps au fantôme
8Depuis Platon, les philosophes et théoriciens de l’art soulignent que les grands génies sont ceux qui voient le monde « avec d’autres yeux » que le commun des mortels. L’abbé Du Bos, le premier à opérer le passage radical d’une poétique à une esthétique au début du XVIIIe siècle, écrit dans ses Réflexions critiques sur la poésie et la peinture en 1719 :
La nature est si variée qu’elle fournit toujours des sujets neufs à ceux qui ont du génie. Un homme né avec du génie voit la nature que son art imite avec d’autres yeux que les personnes qui n’ont pas de génie. Il découvre une différence infinie entre des objets qui, aux yeux des autres hommes, paraissent les mêmes, et il fait si bien sentir cette différence dans son imitation que le sujet le plus rebattu devient un sujet neuf sous sa plume ou sous son pinceau9.
9Plus de deux siècles plus tard, dans son essai sur Van Gogh, Antonin Artaud formule encore cette idée ancestrale dans des termes merveilleux : « … Van Gogh était une de ces natures d’une lucidité supérieure qui leur permet, en toutes circonstances, de voir plus loin, infiniment et dangereusement plus loin que le réel immédiat et apparent des faits. »10
10Le génie est cet artiste hors – ou au-dessus – du commun dont l’œil perce le réel et perçoit un réel invisible, un réel au-delà du réel, ou encore, comme le formule Artaud, « un énigmatique et sinistre au-delà »11. Plus loin, au-delà : là où le même est différent. Une différence infime qu’il s’agit de saisir et de rendre visible au commun des mortels, à ceux qui n’ont pas cette faculté de voir l’invisible. Or, du temps de Du Bos et de Diderot, cet invisible est précisément appelé fantôme12. Par exemple, dans l’Encyclopédie, le génie de l’artiste est défini comme celui qui, « par des couleurs vraies, par des traits ineffaçables, tâche de donner un corps aux fantômes qui sont son ouvrage »13.
11Baudelaire avait parfaitement observé dans ses notes sur Le Peintre de la vie moderne que pour donner corps au fantôme, il faut le poursuivre, le traquer en laissant la main se conduire par « un feu, une ivresse de crayon, de pinceau, ressemblant presque à une fureur » :
C’est la peur de n’aller pas assez vite, de laisser échapper le fantôme avant que la synthèse n’en soit extraite et saisie ; c’est cette terrible peur qui possède tous les grands artistes et qui leur fait désirer si ardemment de s’approprier tous les moyens d’expression pour que jamais les ordres de l’esprit ne soient altérés par les hésitations de la main14.
12Aller vite par peur de laisser s’échapper « le fantôme » qui est dans l’invisible au-delà : Marmontel situait sur ce point le partage entre bon ou mauvais écrivain lorsqu’il observait dans ses Éléments de littérature que ce dernier « demeure, comme Tantale au milieu d’un fleuve, haletant … après l’expression, ou plutôt après la pensée, qui semble lui échapper au moment qu’il croit la saisir. »15 Il n’est pas besoin de perpétuer la distinction entre les bons écrivains et les autres, pour remarquer que toute expérience d’écriture semble confrontée à ce fantôme fuyant qui ne se laisse pas aisément saisir. Dans son engouement pour les formes brèves, Pierre Michon nous fait part d’une telle expérience « tantalesque » de l’écriture :
le récit bref, qu’on peut préparer pendant des mois, doit être écrit d’un seul tenant, dans l’ivresse et la fièvre, peut-être la grâce, sans retour ni repentir, sur la corde raide. Cette mise en risque ne permet que l’échec (la plupart du temps), ou la merveille d’une cinquantaine de pages retombant sur leurs pieds, comme tissées d’échos, nécessaires. Et la moindre fausse note précipite l’ensemble au panier. Le bref ne se rattrape pas16.
13Pour ne pas rester haletant après ce fantôme qui ne se rattrape pas, l’écrivain doit attendre son heure avant d’entrer en lice : c’est aussi ce que laisse entendre Frenhofer, le peintre de génie de Balzac, lorsqu’il insiste sur la patience qu’il faut avoir avant de pouvoir arriver à traquer le fantôme de la beauté, « qui ne se laisse point atteindre ainsi, il faut attendre ses heures, l’épier, la presser et l’enlacer étroitement pour la forcer à se rendre. » (p. 16)
14L’œil et la main, donc : l’œil qui perçoit le fantôme que les autres ne voient pas ; la main qui lui donne corps, vite, d’un trait, dans l’ivresse, pour le fixer de ses contours avant qu’il ne s’échappe. S’emparer de ce fantôme, c’est mener un combat : Marmontel comme Balzac17 emploient le mot pour qualifier le travail de la création. Aussi l’artiste qui dans sa fièvre créatrice garde les yeux rivés sur le fantôme qu’il veut engendrer doit-il repousser une infinité d’images qui le parasitent et tentent de le détourner de son modèle mental. De la même façon qu’Ulysse, descendu aux enfers pour interroger le devin Tirésias, doit repousser de son glaive les âmes des morts qui tentent de l’approcher : âmes-fantômes qui aspirent à retrouver un corps en venant boire le sang du bélier qu’Ulysse a immolé (Odyssée, XI, 23-96). Il n’aura pas échappé à Proust que cet épisode de l’Odyssée forme un exemple saisissant de la création littéraire :
Cent personnages de roman me demandent de leur donner un corps, comme ces ombres qui demandent dans l’Odyssée à Ulysse de leur faire boire un peu de sang, et que le héros écarte de son épée18.
15Pour donner vie à un seul personnage, il faut en sacrifier cent autres : l’épée d’Ulysse vient trancher entre la chair et l’ombre, le vivant et le fantôme. Le glaive marque la limite de l’incarné et du désincarné, du corps et de l’indistinct comme le couteau de Diderot… ou comme le style : car on sait que les premières formes d’écriture nécessitaient ce petit instrument tranchant qui permettait de tracer dans une matière molle – la glaise, la cire – les contours du langage19. Découper la matière (le tableau de Greuze), c’est opérer un partage pour donner jour à une (nouvelle) forme signifiante : c’est aussi le sens premier, et trop oublié, du terme de fiction ; l’étymon fingere signifiant à l’origine « façonner, modeler la réalité », c’est-à-dire transformer, couper la matière pour la plier dans la forme du moule que lui donne le conteur20. Ainsi, toute délimitation de la main qui trace le fantôme est une découpe, qui blesse et départage à la fois21. Littérature et sculpture se rejoignent dans le moment où Diderot tire le couteau de sa poche pour tailler en pièces le tableau de Greuze : il produit alors une fiction en taillant la toile pour repousser l’excédent au rang de fantômes. C’est bien ce surplus, qui est à la source des fantômes qu’engendrent les œuvres, dont s’empare la parole littéraire pour les recréer autrement, dans une différence essentielle, selon le mot de l’abbé Du Bos.
16En amont de la création donc, il y a ce retranchement, cette découpe de fantômes parmi les fantômes pour n’en extraire qu’une partie. En aval de la création, il y a la recréation de l’œuvre, qui se fait à partir des fantômes qu’elle engendre aux yeux des lecteurs ou spectateurs. Ainsi l’œuvre réalisée, matérielle ou textuelle, doit être considérée comme extraite d’un corps plus large laissé à l’état de fantôme, et générant à son tour un monde de fantômes dont l’existence est parfois plus solide que celle des mots ou des images de l’œuvre perçue, dans la mesure où elle permet à l’imagination de « s’emparer des cas pour façonner des récits exemplaires », comme l’affirme Judith Schlanger22.
2. Achever l’œuvre
17Le récit de Pierre Michon, Je veux me divertir, forme un bel exemple d’une œuvre littéraire où les mots achèvent l’image, le tableau perdu. Il faut entendre le terme d’achever dans le double sens de continuer, compléter et de détruire, d’annihiler.
18C’est bien de cela qu’il s’agit dans la nouvelle de Michon. Conformément à l’esthétique des contraires qu’il aime pratiquer23, l’écrivain oppose dans son récit la figure du peintre libidineux, qui va jusqu’à assouvir la toute-puissance du désir par sa représentation dans l’art24, et la figure du narrateur, qui est le curé d’un village un peu perdu en Picardie (Nogent, où séjourna Watteau), et qui est évidemment supposé tout ignorer des plaisirs de la chair. Le curé et le peintre : le témoin de Dieu qui se fait témoin du peintre – témoin, destructeur et créateur du peintre, car c’est bien le narrateur qui aura détruit l’œuvre de Watteau, du moins la partie pornographique, à la demande expresse de celui-ci lorsqu’il sera arrivé à la veille de sa mort. L’extrait relatant l’acte de destruction des tableaux se situe dans les dernières pages de la nouvelle :
Il ne quittait plus le salon bleu. Il faut peu de place pour mourir. Là, le deuxième dimanche de juillet, vers midi, il me demanda de détruire les toiles de l’aile sud, étant trop faible pour le faire lui-même. Je ne le voulais pas ; depuis que je l’ai fréquenté, les besognes de l’art m’intimidaient ; je les devine épuisantes, ténues, plus fragiles que ce qui vit. Je refusai donc ; la colère que j’attendais ne vint pas. Il me dit avec un ton de grande fatigue que sa mémoire devait être de bonne compagnie, si lui-même ne l’était pas ; que ce qui n’avait d’abord été que le verso publié de son œuvre inconnue, le petit menuet, le hautbois, préludes et linge, avait fini par en être l’endroit, pour tous, peut-être pour lui-même ; que le recto, l’origine, la peinture scélérate et extasiée sur quoi le reste avait été peint, jeté comme la robe sur le ventre ou le verbe sur la langue, n’avait pas plus d’existence et ne méritait pas de survivre davantage que les vagissements du nouveau-né et ceux du moribond, les cachotteries de sage-femme et de polichinelle : que ce n’était peut-être que cela, la peinture, ce jeu de robes. Et ce jeu seul méritait de durer. … Aux anges ses catins, aux hommes ses marquises : il ne reviendrait pas sur ce partage. Il dit encore, et la colère montait en lui, qu’il voulait jouir d’elles une dernière fois, livrées aux flammes.
Je les brûlai.
Cela prit tout le milieu du jour. (p. 61-63)
19Dans ce récit, les mots achèvent l’image incendiée dans les deux sens que nous avons relevés : ils complètent le tableau et le détruisent en même temps. Premièrement, les mots évoquent la partie de l’œuvre que Watteau veut détruire, la partie devenue souterraine, mais qui à l’origine était première. Toute œuvre achevée est ainsi vouée à devenir seconde, à être effacée : l’œuvre achevée est toujours inaccomplie. C’est précisément pourquoi l’œuvre littéraire peut achever l’œuvre peinte : comme l’explique Pierre Michon, il incombe au texte littéraire de rendre visible « ce que les peintres appellent les repentirs, les ébauches, les hésitations, tout ce qui précède et fonde la version définitive. La trace de tout cela est permise à l’écrivain, quand au contraire le peintre fait tout pour l’effacer »25. La littérature se nourrit donc des fantômes conjurés du peintre, de la destruction première de ce qui est relégué au rang de palimpseste de son œuvre, et voué à disparaître. De la même façon, tout le récit de Michon sur Watteau est né d’un tableau de ce peintre, le Gilles26, dont Je veux me divertir s’attache à raconter le « verso », le « dessous ».
20Mais les mots achèvent le tableau aussi dans la mesure où ils le détruisent, et le récit de Michon a ceci de particulier que la main destructrice est précisément celle de la recréation de l’œuvre. La figure du narrateur confère en effet au récit tout son intérêt : le curé de Nogent (tout comme les autres narrateurs de récits de peintres célèbres de P. Michon) manifeste un évident « échec à écrire »27. « Les besognes de l’art m’intimidaient », affirme-t-il, s’affichant ostensiblement comme non-expert d’art. Et cette position d’ignorance se traduit par son incompétence de témoigner de l’œuvre dont il ne garde aucune mémoire précise : les « je ne sais plus », « je me souviens mal », « je n’en suis plus si sûr », « je ne sais lequel » pleuvent dans sa narration, par ailleurs trouée de modalisateurs et d’ellipses. Dissymétrie donc entre le plein-pouvoir de la parole et le non-savoir, le silence de celle-ci. La parole du narrateur, qui se veut la seule parole juste, bute d’emblée sur l’ombre de l’œuvre : sur ce qui lui échappe, sur l’enfoui, le caché, l’impénétrable. Par excellence, pour un curé, le sexe, bien sûr, qui se cache dans l’ombre des futaies, et qui réduit ce malhabile témoin, ce Pierrot un peu gauche, à tâtonner dans ces « ombres recluses » pour n’en tirer qu’un discours modalisant, dans une écriture défaillante qui tue l’œuvre : qui en dit l’envers et la fait disparaître dans le même geste. Les « je ne me souviens pas ; je ne sais plus » sont l’incision de la parole ignorante et impuissante de ce Pierrot-image de Watteau qu’il a plu à Michon de faire curé en vêtements de zani, bouffon malhabile qui ne sait « rien de ce qui s’était passé »28 et qui regarde son lecteur de face, les bras ballants. « Échec à écrire » donc, reflétant un échec de peindre : « C’est dans les deux cas un dispositif oblique », affirme Michon, « qui me permet de réfléchir sur ce qu’on appelait naguère la création, la production d’art, ici pictural, et là littéraire. »29 Il y aurait donc ici quelque chose comme un « ratage créateur », mais en quoi cette rature est-elle révélatrice de la création ?
21Dès les premières pages du récit, le narrateur bute sur le silence de Watteau, qui apparaît comme un personnage impénétrable. « Il voulait se taire, il voulait qu’on s’offrît à ce silence ; et que dans toutes ces robes il fût la seule main, avec pour tout commentaire celui, pétillant comme un langage, des retroussis de soie à l’instant forcené. » (p.9) La métaphore du langage comme un « pétillement » est significative. Le pétillement, dans le récit de Michon, est autant celui du « retroussis de soie » au moment de la jouissance, que celui des tableaux brûlés par les flammes dont le narrateur dit explicitement qu’« elles pétillaient » (p.63). Il y a plus exactement une triple jouissance chez le peintre : il veut jouir des femmes, jouir de les peindre, jouir de les brûler ; et toutes ces formes de pétillement sont rendues dans le langage non moins pétillant du Pierrot-curé : un langage défaillant, prêt à vaciller comme la flamme destructrice. Le pétillement est en effet un moment fragile d’apparition-disparition, un éclair d’invisible qui touche peut-être au mystère de la création. Dans ses Propos sur la littérature, P. Michon revient sur cette question dans les termes suivants :
C’est peut-être que la peinture à la fois redouble les apparences et fait douter d’elles, les fait vaciller. Peut-être comme ma façon d’écrire, à la fois épaisse et en attente d’une apparition de l’invisible. J’ai du mal à en parler, ce sont des choses de théologien… Mais je peux dire que mon appétit d’écrire – cette grande magie, cet appel, cet élan – doit prendre pied dans une sorte d’hallucination perpétuelle, c’est-à-dire dans quelque chose de violemment visuel, de visible, de redondant, fort, chargé, et en même temps tremblant, prêt à disparaître30.
22Si l’art est pour Michon à la fois apparition et vacillement dans l’invisible, alors son écriture sur les tableaux disparus (et que ce soient ceux de Watteau n’importe pas) forme peut-être le récit métaphorique de l’essence même de la création dans la mesure où elle doit saisir, présentifier dans un scintillement ce moment de l’apparition-disparition : cette fragile révélation de l’invisible au-delà. Et il importe de souligner que ce scintillement n’est qu’un point, qu’un moment, infime, tangible et fuyant, non pas un presque mais un non-fini. C’est, pour reprendre une formule de Diderot dans ses Essais sur la peinture, le point sur lequel se trouve l’artiste quand il est « sur la dernière limite de l’art »31 : juste avant celui de tout gâter et de tout réussir. Il y aurait donc une limite, un point précis de basculement du fini en non-fini, du recto en envers32.
23Cette limite franchie, les figures peintes deviennent « des couleurs confusément amassées et contenues par une multitude de lignes bizarres qui forment une muraille de peinture », comme le montre Balzac dans Le Chef-d’œuvre inconnu (p. 55). Dans cette nouvelle, le peintre de génie Frenhofer aurait rivalisé avec Pygmalion, en créant une figure de femme parfaitement vivante33. Mais quand Frenhofer déclare avoir touché à la perfection de l’art, en rendant vivante la figure peinte, il prononce les mots mêmes de la destruction : « Où est l’art ? perdu, disparu ! » (p.53), tandis que son visage est « enflammé par une exaltation surnaturelle » et que ses yeux « pétillaient ». Avant d’être celui du feu dont Frenhofer incendie son œuvre à la fin du récit, le pétillement de la flamme est celui des yeux de l’artiste, devenu lui-même le feu destructeur de l’œuvre. Ses yeux et sa main sont la flamme pétillante qui font disparaître l’œuvre dans le moment de vacillement de la figure au brouillard, de l’art à la vie.
24Ainsi, en donnant la vie à l’œuvre, Frenhofer a franchi la « dernière limite de l’art » que Diderot observait chez bien des peintres, et l’échec qui l’attendait au sommet de la réussite le pousse au suicide en même temps qu’à la destruction définitive de son œuvre. Aucun peintre ne franchit impunément cette limite, comme le montrera encore Zola dans L’Œuvre en réservant le même destin tragique à son Claude Lantier. La destruction du peintre et de son œuvre pose donc la question de l’échec de l’art : si le peintre doit saisir et fixer le fantôme de l’au-delà sur la toile, il ne peut impunément transformer le fantôme en vie incarnée34. Mais s’agit-il bien d’un échec ? N’est-ce pas là une forme de ratage créateur, tel que nous l’avons observé dans le récit de Michon ?
25Lorsque Porbus et Poussin, les deux peintres venus admirer le chef-d’œuvre inconnu de Frenhofer, se trouvent face à la toile gardée si longtemps secrète, ils ne perçoivent distinctement dans l’immense brouillard des couleurs qu’un pied de femme, seul reste épargné du corps détruit par les retouches incessantes de l’artiste :
En s’approchant, ils aperçurent dans un coin de la toile le bout d’un pied nu qui sortait de ce chaos de couleurs, de tons, de nuances indécises, espèce de brouillard sans forme ; mais un pied délicieux, un pied vivant ! Ils restèrent pétrifiés d’admiration devant ce fragment échappé à une incroyable, à une lente et progressive destruction. Ce pied apparaissait là comme le torse de quelque Vénus en marbre de Paros qui surgirait parmi les décombres d’une ville incendiée. (p. 55)
26Le pied de la belle Noiseuse est le seul élément laissé inachevé au moment où Porbus et Poussin entrent dans l’atelier : Frenhofer les avait prévenus qu’il manquait encore quelques dernières retouches au tableau, dans l’attente de trouver le modèle idéal (qui sera Gillette). Ce reste, ce « fragment échappé à une incroyable … destruction » est ici considéré par ses visiteurs comme une perfection sans comparaison, tandis que la figure est effacée, détruite par la quête de l’idéal de l’artiste. Mais paradoxalement ce reste d’œuvre, qui correspond à l’idéal classique de l’imitation parfaite, est le fragment resté inachevé aux yeux de Frenhofer : le seul qui n’avait pas encore franchi la limite de l’art vers la vie. Il importe de souligner ici que Poussin forme le représentant de l’art classique à son apogée : son œil est la mesure parfaite du réalisme classique qui considère l’effacement de la figure en ces nuages de lignes comme un « échec » de l’art. La belle Noiseuse ne peut être qu’un amas confus de lignes et de couleurs, un « brouillard » indéchiffrable pour celui qui juge de l’art par le crible du réel. Mais on peut considérer aussi la toile de Frenhofer, illisible et impossible à reconstituer pour un classique comme Poussin, comme l’image littérale du caractère indéfinissable de l’art, selon le terme employé par Balzac pour qualifier la matière même de son récit, dont le caractère fantastique semble le plus apte à pouvoir lui donner forme. Et Balzac commente de la façon suivante le terme d’« indéfinissable » :
Admirable expression ! elle résume la littérature fantastique ; elle dit tout ce qui échappe aux perceptions bornées de notre esprit ; et, quand vous l’avez placée sous les yeux d’un lecteur, il est lancé dans l’espace imaginaire, alors le fantastique se trouve tout germé, il pointe comme une herbe verte au sein de l’incompréhensible et de l’impuissance…35
27« L’incompréhensible » du fantastique est figuré dans la toile de Frenhofer par l’illisible des « lignes bizarres » et « couleurs confusément amassées ». Cette toile brouillée n’est alors pas l’échec de l’art mais la figuration de son indéfinissable, ou, selon un mot qu’emploie encore P. Michon, « l’indécidable »36. Ce que Frenhofer donne à voir à Poussin et Porbus, qui ne le comprennent pas, c’est le point de vacillement, de basculement « tremblant, prêt à disparaître », comme le pétillement de la flamme, et qui suppose l’incomplétude de l’œuvre. La toile de Frenhofer, en effet, est presque achevée (presque détruite, à un pied près), mais cet achèvement est une incomplétude nécessaire pour que le lecteur puisse être « lancé dans l’espace imaginaire », selon les mots de Balzac. Autrement dit, l’indéfinissable de Balzac, l’indécidable de Michon sollicitent l’imagination du lecteur pour lui laisser la liberté de recréer l’œuvre37. Dans son engouement pour l’esquisse, qu’il préfère au tableau, Diderot se réclame de cette même incomplétude de l’œuvre au profit de son achèvement par le spectateur : « plus l’expression des arts est vague, plus l’imagination est à l’aise », déclare-t-il dans son Salon de 1765 devant une esquisse de Greuze38, comme s’il réclamait à voir le « brouillard sans forme » de Frenhofer. Et dans son Salon de 1767, admirant les esquisses d’Hubert Robert, il reformule encore cette intuition profonde de l’art moderne : « L’esquisse ne nous attache peut-être si fort que parce qu’étant indéterminée, elle laisse plus de liberté à notre imagination, qui y voit tout ce qu’il lui plaît »39.
3. La hantise de l’œuvre
28La rencontre entre Diderot, Balzac et Michon a donc lieu dans leur commune recherche d’un indécidable de l’œuvre, qui implique le refus de la saturation. Si Diderot préfère l’esquisse au tableau, le récit de Balzac et ceux de Michon adoptent la forme brève : celle qui tâche d’approcher au plus près de la dernière limite en ne rendant que ce que Michon appelle « l’épure du roman, son minimum vital, … l’essentiel »40. L’œuvre épurée comme l’esquisse sont les formes d’un art essentiel, qui implique de considérer toute œuvre, tout tableau comme incomplet. L’incomplétude laisse alors une place au lecteur ou au spectateur pour qu’il puisse investir l’œuvre de son imagination. « Quand on peint, faut-il tout peindre ? De grâce, laissez quelque chose à suppléer à mon imagination »41, lance Diderot à l’égard de Boucher qui remplit ses tableaux jusqu’à l’excès, et il aurait pu dire comme Michon, « laissez le bref jouer avec la liberté absolue »42 pour que le spectateur puisse achever l’œuvre : la rêver, la continuer, bref, la quitter et la refaire (autant devant l’œuvre ou durant la lecture, qu’après elle).
29L’œuvre incomplète est celle qui ouvre à un éventail de possibles dont l’œuvre n’est qu’une partie incarnée, et qui engendre ainsi des fantômes par un effet de résonance permettant au lecteur de recréer l’œuvre. Pierre Michon a une formule merveilleuse pour dire la résonance de l’œuvre incomplète : « Je voudrais que, le livre une fois refermé, l’épure de ce récit minimal soit claire au lecteur, strictement évidente et longuement résonnante comme le sont les rimes d’un sonnet. »43 Cette pensée fait écho, pour ainsi dire, avec celle de Diderot dans son Salon de 1761 : « Il y a des figures qui ne me quittent point. Je les vois. Elles me suivent. Elles m’obsèdent. »44 La résonance est comme un jeu d’échos de mots ou d’images, qui hantent le lecteur ou le spectateur même après qu’il ait fermé le livre ou quitté le tableau : comme si l’œuvre s’était emparée de lui. Baudelaire n’aura pas plus que Diderot, Balzac ou Michon échappé à cette hantise de l’œuvre dont il fait part dans sa critique d’art en reprenant à son compte un vers de Théophile Gautier : « Et le tableau quitté nous tourmente et nous suit »45.
30De la libre rêverie qui verse dans l’oubli à l’obstination de l’imagination qui « s’empare »46 du fantôme résonant de l’œuvre pour la recréer autrement, toute une série de formes d’achèvement sont possibles par le lecteur tourmenté. L’oubli et la réécriture de l’œuvre formeraient les deux extrêmes de la chaîne des achèvements possibles, qui impliquent toujours l’effacement de l’œuvre, sa disparition dans les couches insondables d’un récit ou d’une image devenue le « verso » de ce qui était premier.
31Dans ces différentes façons de se saisir des fantômes de l’œuvre pour la recréer autrement, on pourrait avancer que la démarche de Diderot diffère essentiellement de celle de Balzac et Michon. En effet, si Diderot préfère l’œuvre non-finie, incomplète, il laisse au spectateur la possibilité de procéder à une reconstitution par métonymie, selon un principe d’harmonie qui est le propre de son écriture dans les Salons : un beau pied annonce nécessairement un beau corps, et Diderot ne cesse de reconstituer la mesure des corps des figures cachées par les draperies à partir des fragments qu’il peut en voir. De toute autre sorte est l’achèvement de l’œuvre chez Michon. Sa nouvelle sur Watteau forme plutôt une reconstitution par métaphore : elle montre que la relation est par essence rompue, sapée par la différence intérieure de l’image brisée, d’où l’échec de la narration. C’est sans doute le Chef-d’œuvre inconnu de Balzac qui constitue l’étape décisive de la rupture dans la reconstitution métonymique d’un tout. Le pied de la belle Noiseuse qui sort du brouillard de la toile est un le fragment d’un tout irrécupérable, dont la reconstitution n’est désormais plus possible, et qu’on ne peut plus recréer que par métaphore, à travers la différence essentielle.