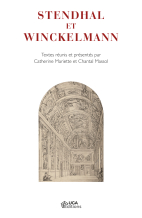
Deux hommes de goût
1La belle « Bibliothèque stendhalienne et romantique » des éditions de l’Université de Grenoble s’est enrichie d’un nouveau titre avec ce Stendhal et Winckelmann, fruit de la collaboration franco‑allemande engagée autour d’un colloque international qui s’est tenu à Grenoble en mai 2013 à l’initiative du Centre d’études stendhaliennes et romantiques et de la Société Winckelmann, à l’occasion du xxe anniversaire du jumelage entre les villes de Grenoble et de Stendal, qui abrite le musée Winckelmann. Événement qui a donné lieu à deux ouvrages collectifs : l’un, en langue allemande, Stendhal und Winckelmann. Stendhal in Deutschland1, édité par la Société Winckelmann, et le présent volume, qui réunit neuf contributions en français de spécialistes reconnus de Stendhal, lesquels mettent logiquement prioritairement à profit l’Histoire de la peinture en Italie (1817), qui concentre les réflexions esthétiques de Stendhal, accumulées dès 1811, à la suite de l’éblouissement provoqué par l’observation directe des chefs‑d’œuvre de la Renaissance ou de l’art baroque, sur cette terre italienne qui en est saturée.
2De fait, jalon majeur où Stendhal se déprend du discours d’escorte de l’érudition qui étouffe l’œuvre (p. 49) pour poser un regard neuf parce que personnel sur un patrimoine culturellement consacré, l’Histoire de la peinture en Italie esquisse les linéaments d’une théorie du goût qui passe par la discussion des thèses venues de Winckelmann sur le beau idéal, dans ses modalités antique et moderne (livres IV à VI), un beau idéal dont la dictature normative est récusée, actant l’historicisation des catégories esthétiques tout en infléchissant l’histoire de l’art dans un sens résolument égotiste et qui ouvre sur ce que Jacques Rancière devait plus tard caractériser comme le « régime esthétique de l’art », « régime de perception, de sensation et d’interprétation » qui inaugure « une forme d’expérience spécifique » (p. 16) qui consiste, ainsi que le rappelle Muriel Bassou, à « faire sentir les arts » pour « redonner la vue aux aveugles » (p. 47). Et qui remet l’histoire en marche en actualisant, comme allaient le faire, quelques années plus tard, pour le théâtre, les deux versions de Racine et Shakespeare, la critique du goût, indexée sur la notion de plaisir — du texte comme des yeux — et dépouillée de toute prétention à l’universalité. Aussi bien, et quitte à gauchir en systématisant abusivement la pensée de Winckelmann, quitte aussi à minorer sa dette à son égard, Stendhal qui, avant Baudelaire, tient pour une critique passionnée, tient en réserve une translatio imperii : « Tous les gens à sensiblerie citent Winckelmann ; dans vingt ans, si l’opus [Histoire de la peinture en Italie] réussit, on citera l’opus »2. Une relève qui repose sur une autre translatio, où l’Italie de la Renaissance prend la place de la Grèce antique, si chère à Winckelmann (p. 21) en même temps que la peinture évince la sculpture, nonobstant le cas Canova, dont il est rappelé que Stendhal avait pour lui « une passion presque fanatique » (p. 42), Canova sur lequel Daniela Gallo s’appuie pour articuler sa lecture : « Le Canova de Stendhal. Une perception winckelmanienne » (pp. 123‑133), où passe une réinterprétation du beau idéal.
3Si, comme l’introduction ne fait pas difficulté à le reconnaître, la question du rapport de Stendhal à Winckelmann est loin d’être neuve — l’article de Francis Claudon, « Stendhal et Winckelmann : encore ? », pp. 27‑46, première des études ici rassemblées, affronte d’emblée la difficulté qui prend acte de ce que « [a]u bout de vingt ou trente ans la matière est difficilement renouvelable » (p. 27) —, l’intérêt de cet ouvrage réside dans la mise en évidence d’une relation qui vectorise l’approche esthétique stendhalienne, chacune des études qui le composent s’attachant à appréhender le large spectre par où Stendhal et Winckelmann prennent contact et par où la rencontre se produit, entre influences, médiations (Louis‑Joseph Jay, Luigi Lanzi, Mme de Staël...) ou transferts culturels.
4L’introduction, due aux deux éditrices scientifiques, Catherine Mariette et Chantal Massol, touche particulièrement juste et, faisant justice d’une tradition critique attachée à interpréter sur un mode purement exclusif la relation entre Stendhal et Winckelmann, envisage tous les aspects de la question, à commencer par l’emprunt pseudonymique à la ville natale du savant allemand et la lecture de ses œuvres (de première ou de seconde main, « peut‑être dès 1797 », à coup sûr « à partir de 1812 », p. 13), le tout impeccablement resitué dans le contexte culturel alors dominant, favorable aux canons du néo‑classicisme entre poétique des ruines, manie antiquaire et revival d’une Antiquité qui prend des allures de manifeste, politique autant qu’esthétique, dans une contamination réciproque dont François Hartog a suivi registres et déclinaisons3. Un retour à l’antique à large spectre, puisque à même de servir aussi bien la conception révolutionnaire de la liberté que l’ordre impérial, voire, quitte à se dégrader en académisme, d’offrir une belle résistance pour faire pièce au retour du style troubadour, sous la Restauration.
5Irréprochable scientifiquement, scrupuleusement informée et mobilisant à propos la riche littérature seconde qui l’a précédée, l’introduction est d’une grande clarté, qui met en évidence les notions identifiées comme particulièrement opératoires pour penser la rencontre : style, liberté, énergie, idéalisation, expression, sentiment, sensibilité... dont les contributions vont ensuite se charger de préciser le contenu.
6Ce qui fait le prix de ce livre, c’est de se situer expressément, en revenant à Alexander Gottlieb Baumgarten et en donnant toute sa place à son Æsthetica (1750‑58), dans ce moment particulier où, quand l’observation directe des œuvres prend le pas sur l’approche philologique qui se contente de les décrire, quand le « modèle sensualiste » vient relayer « le rationalisme des classiques » (p. 23), s’invente l’histoire de l’art et s’élabore un corpus référentiel qui, pour Stendhal, concourt à déplacer le beau idéal de Winckelmann de la statuaire grecque vers la peinture Renaissance, quand bien même l’iconographie retenue pour illustrer le volume fait une part singulièrement belle à la sculpture. Dans ce chantier en construction qui accouche d’un champ disciplinaire neuf, les références aux concepts, aux théories et aux théoriciens qui les ont portés et dont Stendhal, au même titre que de Winckelmann, est l’héritier — au premier chef Le Brun, Lessing, Quatremère de Quincy — sont heureusement introduits pour ce qu’elles sont : des intercessions dans l’appropriation d’une culture esthétique et dans la formation de ses propres principes esthétiques et de son propre système théorique, adossé aux ressorts de la subjectivité.
7L’excursus en terrain esthétique progresse étayé par des références bibliographiques nourries qui prennent en compte l’état le plus récent de la recherche — dont l’essentiel est épris dans un fort utile appendice bibliographique, synthétique et raisonné (pp. 175‑180) — et l’équilibre est savamment maintenu entre la nécessaire érudition requise par une publication universitaire et la lisibilité susceptible d’attirer un public plus large d’amateurs éclairés. Ce faisant, il met l’accent sur le changement de paradigme qui intervient alors dans le régime esthétique. Notamment quant au rôle de la liberté, dont Winckelmann fait, avant Stendhal, la cause première de la supériorité artistique des Anciens, ouvrant sur la « politisation de l’esthétique », qui les voit converger.
8Affichant l’ambition de « penser à nouveaux frais la relation de Stendhal à Winckelmann » (p. 25), le livre contient beaucoup d’aperçus stimulants sur le rapport gêné de Stendhal à Winckelmann, qui le tient en lisière comme un modèle formateur mais devenu trop encombrant, « figé dans une posture d’autorité » (p. 54) qui fait écran à la réception, au point que M. Bassou le regarde comme « un contre-modèle » (pp. 47, 49) pour Stendhal, tout en insistant sur la portée dialogique de la référence, au cœur du dispositif critique qui fonde l’Histoire de la peinture en Italie, entreprise où Winckelmann l’a précédé mais que Stendhal réoriente, théorisant « une nouvelle posture critique en se mettant en scène au cœur de l’ouvrage » (p. 48), gage d’une réception personnelle et singulière, débarrassée des lieux communs qui tiennent lieu d’appréciation des œuvres d’art, le préalable étant, pour qui ne veut pas voir les yeux fermés mais en amateur livré à sa fantaisie (p. 57), d’« oubli[er] le savant Winckelmann » et son écrasante érudition qui fait barrage à l’émotion, quand « il faut que les arts tiennent au sentiment et non à un système ».
***
9L’Histoire de la peinture en Italie fait ici figure de véritable fil rouge qui traverse la réflexion des chercheurs ayant contribué à ce volume, unanimes pour conclure que l’esthétique stendhalienne se construit sur la référence aux théories de Winckelmann. Mais ce dans une oblicité qui ne dit pas son nom. Car le mérite de cet ouvrage est aussi de donner à comprendre comment, derrière l’occultation, voire le déni, de la référence winckelmannienne, celle‑ci a néanmoins joué pour donner forme à la vision proprement stendhalienne de l’art. Ouvrant même sur un au‑delà de l’art (p. 78) quand l’étude de Gérald Rannaud, centrée sur les « stratégies de diversion » (p. 69) que déploie l’Histoire de la peinture en Italie, montre brillamment que la théorie stendhalienne de l’art est à rapporter à une conception plus englobante, qui relève d’une science de l’homme, d’une anthropologie, les catégories forgées dans le champ esthétique se chargeant de résonances éthiques qui décloisonnent et activent tous les passages, symboliques comme sémantiques, quand l’Histoire de la peinture en Italie active des leviers qui posent le texte en « essai d’analyse “idéologique” » (p. 72) où la physiologie a toute sa place, dans la logique organique des perspectives ouvertes par les travaux de Cabanis.
10Après quoi le bel article de Michel Arrous exploite la notion d’expression, « critère du jugement esthétique depuis le xviie siècle » (p. 80), dont il montre bien que, parce qu’elle touche aux catégories de la vérité et du naturel, travaillée par Stendhal dans un sens particularisant plutôt que généralisant, elle va permettre de renouveler les canons du classicisme, dispensateurs d’une esthétique, peut-être sublime, mais froide, très loin des besoins, y compris moraux, qui sont ceux des modernes tels que Stendhal n’a cessé de les définir (pp. 81, 88). Et quitte à mobiliser pro domo une notion compromise du côté des lectures universalisantes, l’idéal, qui fait désormais couple avec l’imagination, cette imagination qui a retenu Letizia Norci Cagiano (pp. 95‑108) – remotivant ces réflexions de Winckelmann : « J’entends par idéal une réunion de choses que la nature ne présente point et que l’imagination peut présenter » – si bien que l’on peut à bon droit avancer qu’« idéaliser, ce n’est pas tourner le dos au réel » (p. 89). Ni, sans doute, totalement à Winckelmann.
11Et c’est dans cette tension tenue qui, tout en maintenant le dialogue, joue subtilement de l’intrication des voix, des changements de registre, des réfections sémantiques qui affectent les notions sollicitées comme les canons du classicisme cessent de s’imposer comme des normes incontestables que réside la réussite majeure d’un ouvrage qui prend toutes les précautions pour aborder ce moment particulier de l’histoire de l’art et de l’esthétique qui, sur 150 ans, de Winckelmann à Nietzsche, renouvelle profondément les conditions de la réception des œuvres d’art.

