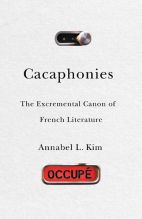
« Là où ça sent la merde, ça sent l’être »
1Les lecteurs et les critiques ont longtemps sous‑estimé l’importance de la thématique excrémentielle dans le corpus littéraire français des xxe et xxie siècles. Annabel L. Kim s'inscrit en faux contre cette tendance à censurer les écrits stercoraires contemporains par le biais d’exégèses qui leur dénient toute signification profonde. Ce sont donc, ici, des relectures d’auteurs majeurs qui nous sont proposées, érigeant le propos scatologique en parabole égalitaire, objet littéraire en même temps que réflexion sur la littérature elle‑même.
2On connaît, depuis la copieuse étude que leur a consacrée naguère Gérard Genette1, l’importance et les enjeux des seuils, invites, leurres ou mises en garde liminaires — « voi ch’entrate… » — que le lecteur ne saurait ignorer sans s’exposer à la mystification ou au fourvoiement. Ici, plus qu’ailleurs sans doute, la prudence est de rigueur. Si le propos scatologique est, dans le champ littéraire, moins offusquant que « consubstantiellement ironique », cette ambiguïté affecte du même coup toute exégèse de la prose stercoraire : tout cela est‑il bien sérieux ?
3Avant même d’entamer la lecture de l’essai d’Annabel L. Kim, c’est en effet sur le sérieux de l’entreprise que l’on s’interroge : le titre en forme de calembour digne d’un ouvrage de la bibliothèque Saint‑Victor, la couverture figurant la porte de « toilettes » — puisque l’on use désormais de cet anglicisme euphémique pour désigner nos « retraicts » —, la quatrième de couverture, avec les inévitables jugements louangeurs et la référence rabelaisienne, autant de signes ou signaux qui, tout en éveillant sa curiosité, suscitent la méfiance du lecteur. L’introduction, « We have always been fecal », est précédée d’une épigraphe empruntée à Baudelaire, bien faite pour éveiller la suspicion :
The Frenchman… is an animal of Latin race ; he has no objection to ordure in his domicile, and in literature he is scatophagous. He delights in excrement.
4Cette note d’humeur prise dans Mon cœur mis à nu2 suffit‑elle à formuler d’emblée le postulat sur quoi se fonde l’ensemble des lectures qu’on va nous proposer dans les chapitres qui vont suivre : « French literature is full of shit » ? On peut déjà craindre que ne soient allégrement franchies les limites de l’interprétation — et la référence, dans les dernières pages de l’introduction, aux exégèses de Louis Marin et Jacques Derrida n’est pas de nature à nous rassurer, pas plus que le name dropping associant dans une même fascination stercoraire des auteurs qu’on ne s’attend guère à croiser dans ces parages. On croit comprendre que le projet d’Annabel L. Kim se fonde, grosso modo, sur une remotivation de la formule catégorique de Sartre, ramenée en somme à son sens littéral, au premier degré : « La littérature, c’est de la merde3. » Assertion paradoxalement euphorique, dès lors que l’on se rappelle Rabelais — « C’est safran d’Hibernie » — ou Jarry — « La merde n’était pas mauvaise ». La lecture que propose Annabel L. Kim se fonde sur une assomption de la matière fécale — shit — en tant que materia prima de l’œuvre littéraire, tant au stade de la création, de l’écriture, qu’à celui de la lecture ou de l’exégèse. Cette assomption se manifeste par le parti pris d’exclure du corpus restreint sur lequel portent ses analyses ou ses spéculations — cet Excremental Canon of French Literature — les œuvres qui voudraient ignorer, censurer la merde ou la rendre acceptable par le subterfuge — ou l’échappatoire — d’un transfert « à plus hault sens ». Ainsi, des approches herméneutiques de Bakhtine, des lectures psychanalytiques de Freud, Lacan ou Julia Kristeva ; ainsi des textes de Georges Bataille, lequel est élégamment qualifié de « mouche à merde (shit fly) that circles around the shit that other authors produce and that he cannot bring himself to produce. » Seront donc retenus et commentés huit auteurs, jugés particulièrement significatifs pour l’importance accordée, dans leurs livres, à la thématique excrémentielle : Céline, Beckett, Sartre et Genet, Marguerite Duras et Romain Gary, Anne Garréta, Daniel Pennac. Ceux‑là ne tombent pas sous le coup des accusations de fecal blindness, fecal illusion ou encore fecal filtration, qui permettent d’écarter, outre Bataille, bon nombre d’autres écrivains qu’on s’attendrait à trouver ici — Tournier ou Richard Millet4, par exemple. Sont ainsi convoqués des noms qu’on pourrait dire emblématiques du passage de l’ornemental ou du métaphorique — on pense ici à l’expression brodure de merde qu’on rencontre chez Rabelais dans un contexte polémique — au structurel, puis au conceptuel : la matière fécale est la matière même du travail littéraire. L’exposition crue, scandaleuse, de l’excrément, mieux que les plus subtiles investigations psychologiques, touche au plus profond de l’humain. Artaud l’exprimait brutalement : « Là où ça sent la merde, ça sent l’être5. » Et Guido Ceronetti, plus élégamment : « L’excrément […] épouvante et répugne, à cause de l’odeur d’âme dénudée et anonyme qu’il exhale6. »
5Le choix d’Anne Garréta et de Daniel Pennac — pour leurs romans Dans l’béton et Journal d’un corps — peut déconcerter le lecteur, à supposer que celui‑ci n’ait pas déjà manifesté quelque perplexité en voyant figurer au nombre des élus Marguerite Duras et Romain Gary alias Émile Ajar. Annabel L. Kim a soin, néanmoins, de recourir, à propos de ces choix, à une justification qui tient fort de l’antéoccupation : c’est que, avec ces auteurs qui sont nos contemporains, nous prenons conscience du poids idéologique et de la dimension politique de la merde. Ce qui désenchantait Swift nous console : nous sommes tous et toutes égaux dans la défécation. L’étron est une arme anti‑raciste, anti‑patriarcale, sa présence fonde la démocratisation de la littérature et de la culture :
This last part of the book thus follows on the previous ones, which show how shit makes and thinks, to point to how shit can be used : how we as readers can take shit out of its literary containers and put it to use as well. (Introduction, p. 32)
6Ayant ainsi exposé le propos général de son étude et justifié le choix de ses références, reste à l’auteure à expliciter ce titre que d’aucuns jugeront peu sérieux, voire puérilement provocateur. Ici, on pense à Jarry, encore : « Le bon goût, nous l’emmerdons. » Mais cela va tout de même un peu plus loin que le plaisir puéril de narguer les savants austères. C’est en somme un avertissement liminaire euphémique : le vocabulaire que l’on trouvera à l’intérieur sera plus brutal, nécessairement, puisqu’il s’agit d’en finir avec les pudeurs de langage. Retour au fumier, pour citer le titre d’un récit de Raymond Federman7, c’est‑à‑dire aux mots qu’on qualifiera paradoxalement de propres, ceux‑là que l’urbanité et la délicatesse censurent et qui, dans le mouvement d’une lecture bien conduite, retrouvent tout leur pouvoir de subversion, s’ouvrent à de nouvelles explorations de leur champ sémantique, suscitent de nouvelles exégèses. Ce polylogue herméneutique, ce chœur cacaphonique répond à la richesse du stock lexical stercoraire qui caractériserait la langue française. On voit qu’il y a là quelque apparence de paradoxe : cette surabondante et jubilatoire synonymie — « Appellez vous cecy foyre, bran, crottes... » — enrichie ad libitum par d’innombrables trouvailles argotiques ou néologismes cocasses, traduirait une complaisance obsessionnelle propre au domaine français, alors même que la littérature use de diverses stratégies d’évitement pour ne pas nommer l’innommable. Nous disons apparence de paradoxe, puisque la redondance euphorique des signifiants n’a d’autre fin que de dissimuler ou d’évacuer un signifié révoltant : « Celia, Celia, Celia shits8 ! » Le flux intestinal se confond avec la logorrhée, se perd dans l’inanité sonore de l’accumulation des termes savants aussi bien que dans la vacuité du mot passe‑partout : « Faire en français signifie chier9. »
7Cette émergence ou assomption de la fécalité que s’emploie à illustrer Annabel L. Kim — et dont elle trouve les premières manifestations chez Céline —, n’est en fait rendue possible que par un relâchement, sinon des mœurs du moins de la langue et des règles de la bienséance. L’euphémisation du discours entourant la défécation, les termes et périphrases infantiles ou argotiques ne survivent qu’en tant qu’hypocoristiques vaguement ridicules ou marqueurs pittoresques de proses pseudo‑policières façon San‑Antonio. Dès lors, le mot cru autorise ou impose de nouvelles lectures ou relectures des classiques. Balayées, désormais, les réticences des premiers exégètes du Moyen de parvenir, feignant s’offusquer de métaphores scatologiques que n’aurait pas reniées Louis Marin. De la même manière, les épisodes du « torchecul », de « l’escholier limosin » ou le dernier chapitre du Quart Livre de Rabelais suscitent‑ils de nouvelles interprétations, lesquelles nous dissuadent de nous laisser prendre au leurre d’un hypothétique « plus hault sens », dont la quête pourrait bien n’être qu’une dérobade. Cette levée des censures langagières imposées par la civilité ordinaire affranchit du même coup l’écrivant des anciennes pudeurs : « À cette heure, écris‑tu naturellement. » On n’imagine pas Colette ou Marcelle Tinayre faire état — comme Annie Ernaux dans L’Événement — d’une « violente envie de chier10 », liberté de propos ou couleur de rhétorique dans laquelle il faut sans doute voir une douteuse et dispensable conquête du féminisme. Le discours scatologique est d’une tout autre portée lorsqu’il s’agit, chez Marguerite Duras, d’évoquer l’abjection de l’univers concentrationnaire : la merde, la souillure et l’abstersion s’inscrivent dans une relation dialectique entre déchéance et rédemption, bestialité et compassion dont seule la brutalité du propos peut restituer l’enjeu. C’est dans ces parages que l’on aurait aimé rencontrer Artaud et les verbigérations hallucinées de ses écrits tardifs.
8L’étude d’Annabel L. Kim, malgré son originalité, sa liberté de ton et ses approches audacieuses, n’est pas toujours convaincante à force de se vouloir systématique, fondée sur un corpus délibérément restreint et des choix discutables. On a trop souvent le sentiment d’être dans la surinterprétation, voire dans l’utilisation. Cet essai n’en est pas moins stimulant ; qu’il agace, indispose ou laisse perplexe, il instaure le soupçon, nous amène à réfléchir, à reconsidérer un certain nombre de textes, de préjugés hiérarchiques et de jugements de valeur. Pourquoi, dès lors, ne pas relire les classiques, traquer la fécalité entre les lignes, aborder les œuvres canoniques d’un autre œil — et se rappeler à ce propos la formule d’Umberto Eco, suffisant lecteur s’il en fut : « On lit avec le trou du cul11 » ?

