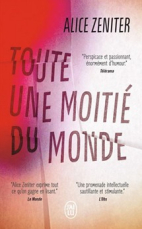
Portrait de l’autrice en lecteur
1Alice Zeniter a été un homme pendant une bonne part de sa vie. Comme toutes les petites filles puis les adolescentes qui s’adonnent à la passion de lire.
2Telle est la découverte que l’autrice de L’Art de perdre (Prix Goncourt des Lycéens 2017) a été amenée à faire au terme du « premier confinement », où, comme tant d’autres, elle a voulu méditer sur son rapport aux livres et à la lecture1. L’état de confinement a d’abord ramené la romancière, comme tout un chacun, au statut de mineur — comment nommer autrement ceux et celles dont les sorties étaient soumises à autorisation, dûment minutées, et les journées suspendues « à des lèvres qui annonçaient ce qui viendrait ensuite » ? La période l’a rappelée aussi bien à ces états d’enfance où elle « cherch[ait] avec avidité dans la fiction des histoires qui seraient l’antithèse de son expérience » et de son quotidien. Au printemps 2020, la quête n’était pourtant plus la même qu’au temps de l’enfance : la lectrice ne demandait plus au pays de la fiction d’être « radicalement étranger à la réalité et que, dans ce pays-là, on sache quel est l’avenir des choses ou des êtres » ; elle espérait a contrario « trouver des fictions qui répondent à [s]on état impuissant et suspendu, à l’incompréhension de l’événement, au morcellement des causes et des temporalités, à [s]on/notre impossibilité de prévoir les conséquences » (p. 12). Les neuf essais rassemblés dans Toute une moitié du monde, qui prolongent chacun à leur façon Je suis une fille sans histoires (L’Arche, 2021) — un monologue qu’Alice Zeniter joue seule en scène depuis 2020 et dans lequel elle interroge la place des femmes dans la littérature —, viennent méditer ce qu’a de paradoxal la demande que tout lecteur adresse aux fictions : « Je veux à la fois que la fiction m’arrache au monde et qu’elle m’éduque sur lui » (p. 13). Si Montaigne n’y est jamais cité, chacun d’eux retient quelque chose de la leçon des Essais, en livrant un autoportrait de l’autrice en lecteur.
« Toute une littérature à laquelle il manque une moitié du monde »
3L’essai qui donne son titre au volume emprunte à Tristan Garcia une formule avancée dans un entretien avec Richard Gaitet pour Bookmakers sur Arte Radio2 : « c’est toute une littérature à laquelle il manque une moitié du monde ». Cette moitié qui manque, c’est celle qui ferait aux femmes la place qui leur est refusée par le canon littéraire — toute une moitié, « ça fait quand même beaucoup », souligne Alice Zeniter. En revenant sur deux décennies de sa vie de lectrice, et six ou sept ans d’études de lettres, la romancière est bien forcée de le reconnaître : ses souvenirs de lecture ne se présentent nullement comme une superbe « frise de personnages féminins aimables, surprenants ou forts parmi lesquels faire [s]on choix » ; au contraire, sa bibliothèque intérieure abrite plutôt
une kyrielle de figures de second plan, objets de désir d’un héros masculin, éléments souvent passifs, propres à être enlevés, séquestrés, empoisonnés (parfois les trois consécutivement), une myriade de silhouettes alanguies, au teint pâli par des amours malheureuses, visage collé à la fenêtre, quelques folles enfermées ici ou là, des princesses cornéliennes mourant comme foudroyées par l’intensité d’un chagrin d’amour, des princesses raciniennes se suicidant pour éviter la disgrâce d’un désir scandaleux, des femmes d’âge mur ou des petites filles abusées et violées, et bien sûr une cohorte d’épouses souvent délaissées, forcément domestiques et tristement adultères (p. 17-18).
4La lectrice qu’elle fut, et jusqu’à l’âge adulte, n’a trouvé à s’identifier qu’à des personnages masculins :
j’ai été Bastien Balthazar Bux, pas la Petite Impératrice, j’ai été d’Artagnan, pas Constance Bonacieux, j’ai été Jean Valjean et pas Cosette — pour la bonne et simple raison que la Petite Impératrice est prisonnière de sa tour d’ivoire, que Constance Bonacieux passe son temps à se faire enlever et que Cosette troque les maltraitances des Thénardier contre la surveillance des bonnes sœurs du couvent, toutes situations qui répliquaient (en les exagérant) l’état d’impuissance qui était le mien et dont je cherchais à m’échapper par la lecture. (p. 20-21)
5Et la romancière de conclure : « j’ai donc été un homme pendant presque tout le temps de ma vie de lectrice » (p. 21). Avant de s’interroger symétriquement sur les expériences de lecture des garçons qui ont grandi près d’elle : « est-ce qu’une fiction leur a permis, au moins une fois, de s’identifier à une fille, à une femme ? » (p. 22) ; les hommes peuvent-il connaître « ce que spectatrices et lectrices pratiquent depuis toujours : une identification indépendante du genre » ? (p. 23). La question est laissée pendante, mais on va voir que l’essayiste y répond quelques pages plus loin, à sa façon et sans trop s’en aviser peut-être.
6Le constat sur cette moitié manquante en appelle un autre, plus troublant, qui touche moins au processus d’identification en tant que tel qu’aux scripts sexuels proposés, ou non, à la part féminine du lectorat :
Il n’existait pas, dans les livres qui m’étaient mis entre les mains, de désir féminin pour les hommes. Et qu’on ne me dise pas que c’est ce dont parle Madame Bovary : quand il décrit l’admiration d’Emma pour les “longues bottes molles” de Rodolphe, Flaubert n’endosse pas le désir d’Emma pour cet homme, il montre que c’est une sotte que le moindre accessoire de mode, aux sonorités ridicules — ces « o » qui se répètent comme un ricochet raté (sans même parler de l’image de la mollesse convoquée ici) —, suffit à mettre en transe parce qu’elle ne sait rien, ne connaît rien. (p. 46)
7Alice Zeniter consacre de belles pages ensuite (p. 32-47) aux héroïnes de deux rares fictions qui ont su « raconter le désir féminin à la manière des femmes » : le personnage de Janie dans Mais leurs yeux dardaient sur Dieu de Zora Neale Hurston, paru en 1937 aux États-Unis, traduit en français soixante ans plus tard3, et celui de Chris dans I love Dick de Chris Kraus, paru en 1997 et traduit par Alice Zeniter elle-même en 20154.
8Vient alors cette confidence sur son arrivée à Paris où elle s’émerveillait des visages et des corps des hommes dans les rues :
La seule littérature qui ait fait écho à mon désir, pendant ces années-là, a été celle de Jean Genet. (p. 47)
9Toute sa vie d’étudiante s’est éclairée à la flamme de cette phrase du Miracle de la rose : « J’aspirais alors à me laisser étreindre par la splendide et paisible stature d’un homme de pierre aux angles nets. » Ce sont ainsi les pages d’un auteur homosexuel qui auront permis à Alice Zeniter de « vivre sereinement [s]on désir de jeune femme hétérosexuelle ».
10On doit s’étonner que ce troisième constat n’ait pas amené l’essayiste à revisiter les deux autres : si une fiction homosexuelle peut se montrer aussi accueillante ou généreuse à l’égard d’une lectrice hétérosexuelle, c’est peut-être que la littérature romanesque peut aussi nous délivrer de toute assignation et fluidifier nos identités, en nous permettant d’essayer différents rôles de genre, et en nous offrant d’autres scripts sexuels que ceux qui nous sont socialement proposés. L’expérience de la lecture ne se résume décidément pas à l’identification univoque aux seules figures héroïques, et la fiction romanesque la plus conventionnelle a toujours plus à nous offrir que des modèles de comportements.
11L’énigme est finalement ailleurs : s’il manquait vraiment à la fiction toute une moitié du monde, comment expliquer qu’elle ait pu avoir autant de lectrices que de lecteurs ? Comment comprendre que la lecture puisse être une activité fondamentalement mixte — ou plus exactement : que les livres puissent être adressés aux lisants des deux sexes, indifféremment et indépendamment de leur orientation sexuelle ? On peut le dire encore autrement : si les lecteurs et lectrices ont bien des pulsions, il n’est pas sûr que les livres aient un sexe.
Qu’est-ce qu’être autrice ?
12Les deux essais suivants sont voués à méditer la condition faite aujourd’hui encore aux autrices en regard de l’accueil réservé à leurs homologues masculins. Alice Zeniter livre ici une série d’anecdotes plus affligeantes les unes que les autres sur les brimades et humiliations infligées par le milieu littéraire parisien aux jeunes impétrantes. Elle y raconte aussi quelles contraintes elle a dû s’imposer lorsqu’elle a fait le choix de mettre un terme à sa carrière académique pour se consacrer à l’écriture : « j’ai commencé en disant que j’étais écrivain — pas écrivaine. Auteur. Parce que je voulais être traitée comme un homme, je voulais d’une certaine manière, aller jusqu’à effacer la femme le plus possible, parce qu’avec la femme venait la suspicion des “romans de bonne femme” » (p. 64). Le succès ne parvient jamais à lever entièrement ce soupçon : alors que pour les écrivains la pratique de l’écriture se confond avec leur vie d’homme, pour les écrivaines « l’écriture sera toujours quelque chose qu’on fera en plus — c’est-à-dire en plus d’être femme, d’avoir un visage de femme, un corps de femme, qui est le sujet premier de l’attention » (p. 65). L’étiquette d’autrice fonctionne dès lors comme « une sous-marque » (p. 71), dont la production ne parvient jamais à rivaliser vraiment avec les produits-phares que sont les œuvres signées par des hommes ; tout est fait au demeurant pour que la concurrence entre auteurs et autrices n’ait pas sa place sur le marché éditorial, comme les polémiques qui agitent régulièrement le milieu littéraire en administrent tout aussi régulièrement la preuve : pourquoi donc les journalistes et une partie non négligeable du public détestent-ils chez Virginie Despentes ce qu’ils adorent chez Michel Houellebecq ?, s’interroge à bon droit Alice Zeniter (p. 72).
13La romancière se demande aussi quel peut bien être le sens de la « parade virile », reprenant l’expression de Julia Kerninon, à laquelle se livrent ses homologues masculins dans les entretiens accordés à une presse elle-même complaisante : dans la filiation d’Hemingway, Faulkner ou London, les écrivains d’aujourd’hui prennent volontiers la pose du baroudeur pour assimiler l’écriture à un exploit ; il suffit de citer quelques propos d’Emmanuel Carrère ou Sylvain Tesson pour apercevoir quel est le « combo gagnant » véhiculé un peu partout : « sport, franche camaraderie, aventures, alcool et tabac » (p. 82). Seule exception à ce qui apparaît comme la loi du genre : Houellebecq, lequel « joue la mort de la France et surjoue la mort du Grand Écrivain français », selon l’hypothèse avancée par Johan Faerber dans Le Grand Écrivain, cette névrose nationale (Pauvert, 2021, cité par A. Z. p. 81).
14Pour mieux donner la mesure de ce qui sépare la condition d’autrice du statut d’auteur, Alice Zeniter se livre à une nouvelle confidence, sur son refus de la maternité :
lorsque j’ai décidé de ne pas avoir d’enfant, j’ai suivi mon désir premier (ou mon absence de désir d’enfant) mais j’ai aussi décidé de ne pas répondre à la question que je me posais régulièrement depuis des années : « est-ce que j’arriverais encore à écrire, à dégager du temps pour l’écriture, si j’ai un enfant ? » (p. 77)
15Qui ne voit que la question ne se pose vraiment que pour les autrices, ou plus exactement : que les auteurs n’ont pas à y répondre publiquement ? Dans le cas d’Alice Zeniter, « décider de ne pas répondre », c’est évidemment répondre, et souscrire au cruel adage latin : Aut liberi aut libri (« soit des livres, soit des enfants »), popularisé par Nietzsche dans Le Crépuscule des idoles 5 et cité par bien des écrivaines contemporaines, de Camille Laurens à Marie Darrieussecq ou Tiphaine Samoyault — qu’elles aient ou non fait le choix qui fut aussi celui de Virginia Woolf, Simone de Beauvoir ou Marguerite Yourcenar.
Sortir du roman
16Le quatrième essai reçoit son titre d’une formule de Sophie Divry dans Rouvrir le roman (Noir sur Blanc, 2007), qui invitait à « sortir du roman as usual », soit : à fuir ces fictions qui demandent « un sujet à la mode, une intrigue vraisemblable et haute en couleur, des personnages bien campés auxquels on peut s’identifier, un style d’une lisibilité digeste, quelque chose de clair, d’immédiatement compréhensible et reconnaissable » (cité par A. Z., p. 87). Alice Zeniter réfléchit ici aux différents visages que prend pour elle l’autorité lorsqu’elle écrit : qu’est-ce qui décide de ce qu’une autrice se donne le droit d’écrire ? Comment expliquer qu’une romancière puisse se refuser, par exemple, le droit à la digression ? « Qui est l’autorité qui se présente ici et qui joue, parfois, contre moi ? La forme elle-même ? L’horizon d’attente d’un lectorat imaginé ? » (p. 88). L’autrice hérite sans doute de la lectrice (du lecteur) qu’elle fut, des goûts « façonnés par une production narrative majoritaire ». L’écriture s’apparente dès lors à un art des limites : comment sortir des formes prédéfinies sans infliger aux lecteurs une expérience pénible, qui ferait tomber le livre des mains ? Car on ne saurait parler d’un abandon du lecteur : « il n’y a pas de réel abandon dans la lecture, uniquement des avancées » ; cette (em)prise doit faire tout le souci du romancier : « qu’est-ce qui fait que ça tient, ou que ça prend ? », que le lecteur ne lâchera pas le livre ? Alice Zeniter médite au passage les fortes leçons de Vincent Message dans Romanciers pluralistes (Seuil, 2013) sur les livres qu’il faut lire deux fois, ou dont la première lecture est presque inévitablement de l’ordre d’un échec, à l’instar de Le Bruit et la fureur (p. 95-96), avant de prendre ses distances avec toutes les avant-gardes : « je refuse que mes livres intimident ». C’est, pour la romancière, avouer qu’elle aura toujours « le cul entre deux chaises narratives » : « je veux écrire des livres qui soient accessibles au plus grand nombre, mais je veux aussi sortir des schèmes préétablis dont je connais pourtant le pouvoir de séduction comme la capacité à rassurer » (p. 97-98).
Aimer, pleurer ou être un personnage
17Le cinquième essai est aussi le plus long (p. 103-142), qui cherche à réhabiliter les relations que lecteurs et lectrices entretiennent avec les personnages de fiction. Alice Zeniter fait ici davantage d’emprunts aux références canoniques (Barthes, Robbe-Grillet, Eco) de la khâgneuse qu’elle fut, sans négliger quelques réflexions plus récentes (celles de F. Lavocat notamment ou de V. Message encore), comme elle se montre soucieuse au sein des autres essais de dialoguer avec des pensées plus contemporaines (T. Morrison, E. Glissant, D. Haraway, G. Albrecht, B. Morizot, V. Despentes, V. Despret…) — regrettons au passage l’absence d’une bibliographie (la courte page des « Copyrights » n’y supplée nullement).
18Ces pages tirent leur prix de s’écrire à la fois dans la lumière d’une vie de lectrice et dans la conscience récemment acquise par la romancière de la puissance propre des personnages. Alice Zeniter y fait notamment valoir (p. 117 sq.) les mérites de l’empathie en regard de la seule logique de l’identification, en s’attardant sur les liens entre fiction et care, lesquels expliqueraient que la pratique de lecture ait pu être longtemps réputée « féminine ». Elle souligne après bien d’autres les mérites cognitifs de notre commerce avec les personnages de fiction : « le lien que je tisse avec les personnages est infiniment plus simple que celui que j’ai avec les personnes réelles et c’est une des raisons pour lesquelles je les chéris » (p. 115).
19Elle ouvre aussi des perspectives inattendues, en faisant valoir que la relation que le lecteur peut nouer avec un personnage ne relève nullement du dialogue ou du tête-à-tête : elle engage à tout coup une communauté — celle des autres lecteurs, réels ou supposés, de la même fiction, mais aussi bien de tous ceux de nos proches auxquels on voudrait pouvoir présenter les personnages auxquels on s’est lié. « Les personnages de mes lectures m’accompagnent si bien qu’il m’arrive d’avoir envie de donner de leurs nouvelles », note ainsi Alice Zeniter (p. 104), pour mieux dire la valeur de ces moments de lecture partagée au fil desquels les personnages deviennent des connaissances communes.
J’ai grandi avec deux sœurs qui lisaient, comme moi, goulûment et vite et nous nous volions les romans les unes aux autres, pour dévorer un chapitre ou deux avant que le méfait soit découvert. Nous avancions presque d’un même pas dans les pays de la fiction et les personnages étaient non seulement des sujets de discussion mais des amis communs (p. 105).
20Une note vient préciser avec ce qu’il faut d’humour que ce partage n’avait rien de serein :
Ou de potentiels amoureux, ce qui était plus délicat : il fallait alors se les répartir car une sorte de code d’honneur nous interdisait d’être amoureuses du même personnage. Les mariages forcés n’étaient pas toujours heureux, notamment pour ma petite sœur à qui n’était concédé que le droit d’aimer des personnages mineurs.
21On se prend à rêver de cette bibliothèque partagée par les trois sœurs, à laquelle toute l’œuvre d’Alice Zeniter se trouve adossée, mais aussi de la définition de la communauté que de tels échanges induisent : une société réunie par les liens noués d’abord isolément avec les mêmes personnages, et par les émotions ressenties à la découverte des mêmes œuvres.
22En dépit d’un développement peut-être un peu irénique sur les sensitivity readers (p. 122), la romancière a encore de très belles pages sur les relations troubles que la fiction entretient avec la morale : si la fiction est le lieu des rencontres déraisonnables et des discussions trop longues avec des enragés, si l’on entre dans la plupart des romans comme dans « cette étrange salle de bal où l’on peut valser très tard avec des monstres » (p. 120), le dialogue axiologique laisse lecteurs et lectrices toujours plus libres qu’on pourrait le penser.
S’il y a débat, quand je lis, entre ma manière de vivre et celles que je croise dans les romans, celui-ci est curieusement serein. Je n’ai jamais l’impression que le mode de vie d’un personnage est un jugement sur le mien : ils peuvent faire ce qu’ils veulent sans que je me demande s’ils pensent que c’est la voie à suivre, et que la mienne, si elle diffère, relève du pis-aller ou de l’erreur d’appréciation.
23Rarement mise en avant, cette sérénité-là invite à nuancer les thèses d’une Martha Nussbaum sur le rôle éthique et politique de la fiction6.
Entrer en relation
24Les derniers essais du recueil reviennent à diverses vues sur les pouvoirs de la fiction et les vertus propres de l’écriture romanesque, dont Alice Zeniter veut croire qu’elle peut tout à la fois « protéger certaines expériences fragiles et évanescentes d’une couverture offerte par la langue » (p. 146) et « dégager certaines expériences des mots de tous les jours » (p. 148). Très inspirée par ses lectures d’Édouard Glissant, Arno Bertina ou Vincent Message, elle fait valoir après eux la fonction politique de la polyphonie — « lorsqu’on n’entend qu’une voix, c’est celle du plus fort » (p. 158) — en rendant au passage un bel hommage à L’autre moitié du soleil de Chimamanda Ngozi Adichie (2007). Elle donne ainsi à comprendre que c’est toujours en elle la lectrice qui écrit :
Je sais que, parce que j’ignore le minutage de tant d’autres existences et la matière réelle de leurs jours, je peux leur faire du tort : acquiescer à une critique qui les vise, ne pas me sentir touchée par un projet de loi qui les contraint… Je sais aussi que je n’aurais pas le temps, même si c’était mon but, de les rencontrer tous et toutes, d’apprendre de leur bouche, par leur fréquentation régulière. Alors je lis pour décloisonner. Je lis pour “abolir le scandale qui consiste à n’avoir qu’une seule vie”, pour reprendre la belle expression de Vincent Message. (p. 160-161)
25Lire ou écrire, c’est toujours accepter d’entrer en relation :
S’il y avait un message diffusé dans des haut-parleurs avant l’entrée en territoire de fiction, il ressemblerait, curieusement, à celui des assurances ou des banques jointes par téléphone : Patientez quelques instants, vous allez être mise en relation. Ce que je cherche, sans doute, depuis le début, en tant que lectrice et en tant qu’écrivaine, ce sont des récits qui me permettent d’entrer en relation avec des êtres qui me sont inconnus et me deviendront proches, tout comme des récits qui leur permettent — à l’intérieur de la fiction — des relations riches, complexes et fragiles. (p. 173-174)
26Parce que tout roman vient offrir de telles relations, la responsabilité propre du romancier tient dans une économie de l’attention, qu’Alice Zeniter médite en relisant La Porte de Magda Szabo (1987, trad. par Chantal Philippe, 2003), La Grand vertige de Pierre Ducrozet (2020), ou Plasmas de Céline Minard (2021) : « Écrire un roman, c’est décider de ce qui a de l’importance, guider l’attention vers certains points au détriment des autres » (p. 181). Responsabilité qu’il faut aussi savoir penser négativement : « Je ne peux m’empêcher de penser que si tant d’espèces ont pu disparaître, c’est qu’elles manquaient déjà au pays de la fiction et que leur absence criait qu’elles étaient quantité négligeable, qu’elles pouvaient disparaître et que le monde continuerait à exister » (p. 190).
27Suivant ici les thèmes et les thèses de B. Morizot, Alice Zeniter en vient à se demander quels modes de narration restent à inventer pour dire la catastrophe qui vient ; l’art du récit ne peut pas ne pas être affecté par le changement survenu dans notre perception collective du futur :
Un récit qui voudrait raconter des phénomènes globaux ne peut pas être l’histoire d’un héros formidable, lancé à l’aventure et prêt à casser des gueules. Personne ne bottera le cul au changement climatique. Ça se racontera autrement, et peut-être que, dans ce grand chantier-là, la fiction occidentale est loin d’avoir toutes les cartes en mains. Le « centre », trop sûr que sa manière de raconter est la bonne, aurait intérêt à se tourner vers les « marges ». (p. 196)
28Elle se demande enfin si ces mutations prévisibles de l’art du roman pourront s’accommoder de la condition individuelle traditionnellement reconnue au métier de romancier :
Peut-être aussi que raconter autrement signifie qu’il faudrait replacer du ou des collectifs au sein même de l’acte d’écriture. […] Certes, [le romancier] est (je suis) nourrie par la bibliothèque du monde qui va toujours augmentant, ce qui n’est pas rien, mais peut-être que cette écriture en solitaire est une autre conséquence ramifiée de la figure du héros qu’il faudrait abolir. (p. 196)
Trouver une fin
29La clausule du recueil nous découvre que, pour rédiger ces essais, Alice Zeniter a renoué avec la très vieille pratique des excerpta chère à Montaigne comme à tous les lecteurs de la Renaissance : elle a ouvert deux ans en amont un fichier intitulé « choses à placer dans le livre », dont elle supprime au fur et à mesure les citations ou les idées qu’elle a réussi à loger, mais qui n’est nullement vide au moment où elle achève le livre (p. 210) — outre que le même fichier comporte la liste des ouvrages qui lui ont été recommandés et qu’elle n’a pas lus. On s’explique mieux que l’essayiste ait pu procéder « à sauts et à gambades », à la façon de Montaigne donc, au risque d’enjamber telle ou telle question logiquement appelée par son sujet — une citation de Nicolas Mathieu ultimement repêchée lui permet de s’aviser qu’elle aura finalement « fait l’impasse » sur la question du style ; une autre, de Jacques Rancière envisageant l’écriture comme accès à « une parole qui rend apte à participer au commun »7, ne s’inscrit sur l’une des dernières pages que parce qu’elle « flotte, un peu perdue, au milieu du fichier » (p. 210).
30Le dernier essai est aussi l’occasion pour Alice Zeniter d’afficher sa difficulté récurrente à achever ses romans (« Quelle forme donner à une fin ? »), ou, plus fondamentalement, sa méfiance à l’égard des fins :
Les fins offertes par de nombreuses fictions font partie des éléments narratifs qui ont le plus orienté et faussé ma compréhension de la vie humaine, de notre rapport au temps. Elles m’ont donné l’illusion que les actions ou les épiphanies sont décisives, les décisions toujours prises pour de bon et que nos existences font plateau lorsqu’on atteint un certain stade de maturité ou de bonheur. (p. 211)
31Écrire, pour un romancier, c’est peut-être toujours faire reculer la fin — trouver une fin « qui dépasse le cadre temporel que s’était jusque-là fixé le récit [en] révél[a]nt l’artificialité de la période choisie par la narration » (p. 213). Comment un essai consacré aux rapports entre lecture et écriture pourrait-il prendre fin ? Alice Zeniter a (finalement) trouvé une façon de ne pas finir en glosant l’inoubliable final de la série Six Feet Under au terme de sa sixième saison.
*
32« Ce livre est un livre d’écrivaine, mais sans doute avant tout un livre de lectrice », déclarait Alice Zeniter au seuil du recueil. La rédaction de ces essais aura fait la démonstration que son être de romancière se confond avec la somme de ses lectures — « Je suis ce qui transforme en ensemble les livres si différents que je cite » (p. 13) —, et que ses propres livres, comme tous les livres sans doute, « sont des livres de dettes » : « celui ou celle qui ne veut devoir rien à personne devrait trouver une autre pratique que l’écriture, laquelle est un palimpseste permanent » (p. 83-84). Loin de ne nous offrir que la moitié du monde, les grandes œuvres nous donnent toujours à lire plusieurs livres à la fois.

