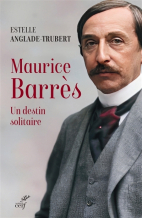
Barrès extime, donc lisible ?
1Le centenaire de la mort de Maurice Barrès, en 2023, a été l’occasion d’une série de publications, heureuse nouvelle sans doute pour un écrivain sur qui l’on n’écrit plus guère depuis plusieurs décennies et qui fut pourtant une référence capitale pour bien des membres illustres de sa génération. Ce contexte éditorial favorable a permis à Estelle Auglade-Trubet de tirer de sa thèse de doctorat une riche monographie, à l’apparence cependant un peu trompeuse : contrairement à ce que le titre simple, Maurice Barrès, et la grande photo colorisée en couverture laissent deviner, il ne s’agit pas à proprement parler d’une biographie, mais plutôt d’un « essai biographique » ou d’un « portrait » (p. 14), et plus exactement d’une étude documentée sur Barrès comme « personnalité publique » (p. 9), « homme en action » (p. 10), ordonnée chronologiquement. Aussi, au sous-titre énigmatique, un peu trompeur lui aussi (« Un destin solitaire »), on pourra préférer le titre de la thèse elle-même, soutenue en 2019 : « Maurice Barrès, écrivain et parlementaire », certes plus sobre, mais qui reflète avec davantage de précision la teneur de l’ouvrage, laquelle s’avère tout à fait captivante.
Littérature et politique
2Écrivain et parlementaire : tout est dans la coordination, qui donne à l’enquête ses pages les plus réussies. L’autrice se propose non seulement de retracer les grandes étapes de l’engagement de Barrès comme député, comme journaliste et plus largement comme publiciste (« communicant », dirait-on aujourd’hui, et l’essai assume cet intérêt pour la « communication politique et journalistique »), mais de scruter la façon dont s’articule, à chaque étape de sa trajectoire, l’espèce de dédoublement indépassable d’un homme toujours « contemplatif et actif » à la fois (p. 13). Examiner Barrès en ses « différentes prérogatives sociales : l’académicien, le journaliste et le militant » (p. 263), c’est comprendre la façon dont le Barrès écrivain se nourrit de façon harmonieuse ou heurtée de ces différentes postures sociales.
3L’essai passe ainsi en revue toutes les grandes étapes du parcours de Barrès, depuis le jeune homme décadent « fasciné par la description des déviances et détraquements de l’espèce humaine » (p. 37) jusqu’aux divers engagements politiques : dans le boulangisme, d’abord, moment fondateur de toute la trajectoire de Barrès, puis dans divers combats plus ou moins durables, tels que la défense du patrimoine religieux, les enquêtes sur le Levant, le militantisme de guerre, notamment l’étonnante défense d’un « suffrage des morts », ou le fameux éloge des « diverses familles spirituelles de la France », et après-guerre son plaidoyer pour la recherche scientifique, ou sa participation aux débats sur le statut de la Rhénanie. Le discours de Barrès se module, s’adapte à chacun de ses combats, à chacune de ses scènes, faisant jouer les différents éthos qui sont à sa disposition, toujours paradoxaux : militant par scepticisme, parlementaire antiparlementaire, académicien mais piètre orateur, président à la fois discret et combatif de la Ligue des patriotes, Barrès est un être en perpétuel « décalage » avec lui-même (c’est l’un des mots-clés de cet essai : p. 154, p. 162, p. 163…). C’est ce qui explique qu’Anatole France puisse voir dans le boulangisme de son cadet un pur produit de « l’ironie » (p. 40), notion qui revient souvent chez les contemporains pour qualifier Barrès, et que l’autrice de l’essai reprend parfois à son compte. Barrès est un ironiste, non pas au sens où il penserait le contraire de ce qu’il dit, mais parce qu’il reste toujours, à un certain degré, dilettante, qu’il apparaît en permanence comme à distance de lui-même, jusque dans ses engagements les plus marqués. L’une des clés de cette impression réside sans doute dans ses difficultés à prendre la parole avec toute l’assurance qu’il voudrait : Barrès est un homme de l’écrit qui fait carrière à l’oral. Un écrivain, donc, qui parlemente.
4Ainsi, l’écrivain et le parlementaire sont distincts, mais non compartimentés, en Barrès : c’est là ce qui rend son cas remarquable. Dès ses débuts littéraires, dans ses articles de presse ou dans les récits-essais du Culte du Moi, Barrès parle en fait de politique, et son boulangisme s’invente d’abord dans les livres ; en même temps, élu député en 1889 à l’âge de vingt-sept ans, il ne cesse de parler de littérature lorsqu’il prend la parole. À la tribune, il se présente comme « l’interprète des littérateurs » (p. 53), défendant la liberté artistique et combattant la censure. Lorsqu’il donne une préface à la pièce de de Paul Adam et Gabriel Mourey, L’Automne, c’est en fait d’un extrait du Journal officiel qu’il s’agit, où Barrès combattait la censure de la pièce : le texte politique glisse dans le texte littéraire, et vice-versa. La porosité des deux grandes postures de Barrès, dans ces premières années, est manifeste, durant ses mandats électifs eux-mêmes aussi bien que lorsqu’un échec électoral le contraint à se mettre davantage en retrait, et se maintiendra longtemps : tout Barrès, jusqu’à sa mort en 1923, réside dans ces incessants « allers-retours entre la politique et la littérature » (p. 210).
5Pour mieux comprendre ce mouvement double, ou ce décalage toujours rejoué, Estelle Anglade-Trubert s’arrête notamment sur deux ouvrages, dans un des chapitres les plus riches de l’ouvrage : Une journée parlementaire, pièce mal connue de 1893 (et seule tentative dramatique de Barrès), et le roman Leurs figures, publié en 1902. L’incursion de Barrès dans le théâtre s’avère encore politique : c’est le « théâtre » de la vie parlementaire qu’il s’agit pour Barrès d’explorer dans Une journée parlementaire : théâtre sur le théâtre, qui est encore un moyen d’articuler « ironiquement » politique et littérature. Quant à Leurs figures, le titre est d’abord celui d’un article politique, en 1893, sorte d’« écrit préparatoire au roman » homonyme (p. 88), et là aussi, c’est la dimension théâtrale du monde politique qu’il s’agit de représenter, « le spectacle de l’homme qui se débat dans ses contradictions » et « la montée de la tension dramatique » propre à la vie politique (p. 89). Le roman se trouve alors comme envahi par la réalité, la fiction par le document, en une tension qui mène ce contradictoire « roman parlementaire qui traite de l’antiparlementarisme » (p. 100) « aux frontières de l’anti-roman » (p. 96). On touche ici non seulement aux idées politiques ou aux postures publiques de Barrès, mais à la question même de l’écriture : nous sommes au cœur de l’ouvrage, et de la thèse qu’il apporte en propre.
6La suite de l’essai consiste davantage à passer en revue, de façon très informée mais moins problématique, la succession des campagnes publiques menées par Barrès ; y apparaissent toutefois d’autres moments d’articulation du même ordre, des effets de décalage, des glissements et des ambiguïtés, qui sont autant de clés de son écriture et de son engagement : son grand projet de « roman sur le Parlement » qui ne verra pas le jour, mais dont l’ambition se répercute sur « une continuité de textes hybrides, fictionnels ou non qui retrace sa carrière de député », avant la Première Guerre mondiale (p. 121) ; sa réponse à Jean Richepin, reçu à l’Académie française en 1909, et occasion pour Barrès d’opposer le mythe nomade de la Bohème littéraire, associé à Richepin, avec une conception plus « sédentaire » de l’écriture, représentée par André Theuriet, prédécesseur de Richepin à l’Académie, le tout formant un « autoportrait en mouvement de Barrès » (p. 181) ; ses tout derniers textes, portant sur Dante, Renan, Bossuet ou Pascal, et renégociant encore d’une manière chaque fois singulière, adaptée au sujet, la conjonction sans cesse rejouée du littéraire et du politique (p. 233 sq.).
7On pourra regretter cependant que l’autrice n’aille pas tout à fait au bout de sa propre thèse : alors que c’est plutôt l’articulation mouvementée, impossible et nécessaire à la fois, du politique et du littéraire, que les plus riches exemples proposés permettent de mettre en avant, la leçon qu’elle en tire est plutôt celle d’une « continuité » et d’une « cohérence » tout en homogénéité (p. 9), d’une heureuse « complémentarité […] entre vie politique et vite littéraire » (p. 205), voire d’une « osmose » (p. 264). La thèse affichée ici se situe en quelque sorte en deçà de ce que l’ouvrage démontre par ailleurs : ce Barrès harmonieux et stabilisé ne donne qu’une idée réductrice de la tension jamais tout à fait résolue qu’explore bel et bien le livre, à travers cette conciliation certes désirée en profondeur par Barrès, mais qui s’avère précisément inatteignable.
Réflexions sur la question antisémite
8La raison de ce « décalage », pour faire à notre tour usage d’un tel terme, en est peut-être le parti pris souvent internaliste de l’enquête, lequel a quelques conséquences beaucoup plus embarrassantes : Barrès a régulièrement tenu à souligner la cohérence de son parcours et de ses engagements successifs, et Estelle Anglade-Trubert prend ces déclarations au pied de la lettre, le discours critique se confondant alors parfois avec le discours barrésien. Or il y a là un penchant que l’’on retrouve à plusieurs reprises dans l’essai, et qui peut gêner le lecteur. Ainsi au début de l’ouvrage, lorsque l’enfance lorraine de Barrès est décrite comme un enracinement tout barrésien, sans distance vis-à-vis de telles catégories, ou dans la conclusion, qui accueille un éloge de Barrès sans doute un peu trop rivé à la terminologie de Barrès une fois de plus (p. 264) : « Aucun de ses combats n’aurait de sens s’il s’envisageait en homme seul. C’est parce qu’il appartient à une communauté nationale à laquelle il est attaché et dont il se réclame qu’il mène à bien ses combats. » C’est avec les outils forgés par Barrès que Barrès nous est conté.
9Pourquoi pas, après tout, et les études littéraires oscillent depuis longtemps entre lectures interne et externe, chacune complétant heureusement les défauts de l’autre ; cependant, une lecture strictement « interne » de certains auteurs est tout bonnement impossible. Cet ouvrage, qui prétend comme quelques autres « lever les préjugés qui ont conduit à penser l’histoire littéraire sans Barrès pour des raisons idéologiques » (p. 9), le fait d’une manière généralement prudente, mais sans prendre assez en compte les « raisons idéologiques » en question, qui méritent tout de même que l’on s’y arrête un peu.
10Au centre de l’ouvrage, inévitablement, nous trouvons un chapitre, ou au moins quelques pages, consacrés à l’affaire Dreyfus et à l’antisémitisme de Barrès. Seulement, ce moment pourtant si capital de la trajectoire de l’auteur (et de sa réception) est diversement minoré : Barrès aurait seulement « trébuché » dans l’Affaire, il aurait été « sommé par son entourage » de s’y ruer, « sympathis[ant] ouvertement avec les convictions antisémites de son milieu » ou de son électorat (p. 104), convictions dont l’autrice rappelle plusieurs fois qu’elles ne sont pas tant celles de l’individu-Barrès que de tout un monde, déresponsabilisant étonnamment un auteur dont elle scrute si finement la singularité dans les autres chapitres. Puisqu’il n’est « pas le seul à avoir choisi le mauvais camp » (p. 105), comme on le lit, Barrès en serait-il moins coupable ?
11Estelle Anglade-Trubert ne nie absolument pas l’antisémitisme de tant d’énoncés sous la plume de Barrès, dont certains sont rappelés dans l’ouvrage : mais à telle « tache dans son parcours », ou à cette « approche […] impardonnable » du judaïsme (p. 104), l’autrice ajoute telle autre formule de Barrès « plaignant » Dreyfus et nuançant ultérieurement sa conviction de la culpabilité ou de la malfaisance foncière du capitaine (p. 104-105), ou telle remarque de Léon Blum rappelant son attachement à Barrès (p. 107), comme si l’admiration affectueuse de Blum compensait en quelque manière que ce soit les errements antisémites de son aîné.
12On trouve mentionné, dans le même ordre d’idées, un exemple souvent mobilisé par les avocats de Barrès : l’éloge des Juifs dans Les diverses familles spirituelles de la France, publié en 1917 dans le contexte de l’Union sacrée. Mais comment ne pas voir ce que ce supposé revirement de Barrès a en réalité d’accablant ? Estelle Anglade-Trubert semble bien sentir l’insuffisance de cet argument, mais n’en tire pas de conséquence : « Si le portrait qu’il fait du grand rabbin de Lyon Abraham Bloch, aumônier engagé aux armées, mortellement touché en apportant un crucifix à un soldat mourant, n’excuse pas son antisémitisme du temps de l’Affaire, il témoigne néanmoins d’une évolution » (p. 106.). Une évolution ? Certes : ici, il ne s’agit plus de déduire la culpabilité d’un innocent de sa seule « race », comme lors du procès de Rennes, en 1899. Cependant, la coloration apparemment amicale de ce texte a un prix : si Barrès consent à élargir son œcuménisme patriotique aux Juifs, c’est en s’appuyant sur une anecdote où un Juif apporte à un chrétien un crucifix (un Christ en croix, donc, symbole du « déicide » dont le plus vieil anitjudaïsme a si souvent accablé les Juifs) : les Juifs ont bien ici quelque chose à se faire pardonner. Nous sommes très loin du philosémitisme d’un Péguy, à la même époque, débarrassé de tout discours de l’infamie, de toute théologie de la substitution et de toute velléité de convertir de gré ou de force le peuple juif, bien que Péguy se trouve discrètement mis au service de l’effort de réhabilitation de Barrès dans l’essai, quand l’autrice fait de Barrès un « être multiple », « à l’instar de Péguy, son cadet » (mais la « multiplicité » de Péguy n’incluait pas l’antisémitisme, précisément).
13Estelle Anglade-Trubert reconnaît bien sûr (car comment le nier ?) l’antisémitisme de Barrès, mais cherche à en amoindrir la portée par des arguments trop légers, les formules de Barrès citées à décharge pouvant généralement être retournées en éléments à charge. Ainsi des Familles spirituelles de la France, donc, ou encore de ces phrases de 1906, l’année de la réhabilitation (p. 105) : « Dreyfus a été le traître pendant douze ans par une vérité judiciaire. Depuis vingt-quatre heures, par une nouvelle vérité judiciaire, il est innocent. C’est une grande leçon, je ne dis pas de scepticisme, mais de relativisme qui nous invite à modérer nos passions. » La leçon que tire Barrès de l’Affaire, c’est celle du « relativisme » : à l’ancienne « vérité judiciaire » de la culpabilité s’est substituée « une nouvelle vérité judiciaire », faisant de Dreyfus un innocent. Mais cette formule, citée ici pour attester l’évolution de Barrès « dans le bon sens », est peut-être l’une des plus accablantes de l’ouvrage : ce que Barrès n’aura pas retenu de l’affaire Dreyfus, c’est précisément la valeur de la vérité, cette vérité dont Péguy, lui, fut l’apôtre infatigable. Pour Barrès, la vérité de l’innocence de Dreyfus, au fond, ne pèse pas plus lourd que l’ancienne « vérité » de sa culpabilité. En lisant ces lignes, on se prend à penser à la fin du Chagrin et la Pitié de Marcel Ophuls (1971), où Christian de La Mazière, ancien SS, volontaire de la Division Charlemagne, conclut posément que ses déboires lui ont appris à se méfier de « l’engagement » et conseille désormais aux jeunes la « prudence ». Après l’antisémitisme, le relativisme, donc.
14Pour bien comprendre ce dont il retourne ici, et le problème que Barrès doit absolument nous poser, au présent, il faut prendre un peu de recul. Remarquons d’abord que l’on trouve un dispositif très voisin dans le livre d’Emmanuel Godo sur Barrès, paru en même temps que celui d’Estelle Anglade-Trubert, et qui cherche lui aussi (c’est bien le problème) à réhabiliter l’auteur : pour Emmanuel Godo, l’antisémitisme de Barrès devrait être nuancé en raison de son caractère non « systématique », et par le fait que Barrès n’était pas sous « l’emprise » du savant Jules Soury, contrairement à ce qu’avance à ce sujet l’historien Zeev Sterhell1. De plus, la Shoah, pour le critique, aussi capitale soit-elle dans notre propre rapport à la question de l’antisémitisme, ne doit pas altérer une compréhension contextualisée de l’engagement de Barrès. Or, procéder ainsi, c’est précisément s’aveugler (volontairement) sur le rôle de Barrès dans l’intense genèse de l’antisémitisme moderne en France et en Europe, qui connaîtra son paroxysme sous la forme du nazisme, c’est vrai, mais dont l’affaire Dreyfus est une étape on ne peut plus décisive (qui conduisit Herzl à théoriser la nécessité d’un État juif dès 1896, bien avant les persécutions nazies). Nul n’est besoin d’enrôler Barrès dans la Waffen-SS pour reconnaître qu’il joua un rôle dans cette histoire, et un rôle non négligeable, parmi malheureusement beaucoup d’autres, en effet.
15Il est compréhensible qu’Emmanuel Godo ait souhaité nuancer certains aspects en effet fort discutables de la thèse de Zeev Sternhell (la stricte équivalence entre le discours biologisant de Jules Soury et l’antisémitisme de Barrès, notamment, mais aussi l’idée d’une influence plus ou moins directe du nationalisme de Barrès sur la gestation du nazisme). Mais une fois ces nuances apportées, l’antisémitisme de Barrès ne se trouve pas moins embarrassant, en réalité. Le minorer, et par là minorer le lien profond entre cet antisémitisme et le reste de l’idéologie de Barrès, c’est refuser de penser Barrès jusqu’au bout, comme penseur politique (non systématique, soit), mais aussi comme écrivain. Estelle Anglade-Trubert, elle, si elle ne propose pas de réfutation directe des thèses de Zeev Sternhell, fait appel à un autre critique récent qu’Emmanuel Godo, lui, passe presque sous silence : Uri Eisenzweig, auteur de Naissance littéraire du fascisme (2013), où Barrès occupe une place centrale, en particulier à travers le roman contemporain de son tournant antidreyfusard, roman étonnamment peu commenté par Estelle Anglade-Trubert, Les Déracinés (1897). Eisenzweig, comme Sternhell, s’intéresse au rôle de Barrès dans la généalogie du fascisme, mais il le fait, quant à lui, dans une perspective profondément littéraire (mobilisant également les œuvres de Bernard Lazare et d’Octave Mirbeau). C’est pour cela qu’Estelle Anglade-Trubert le mentionne ponctuellement (p. 89), mais sans rappeler sa thèse proprement dite : la poétique romanesque (ou antiromanesque) des Déracinés est inséparable de l’antisémitisme et d’un certain rapport à l’anarchisme, chez Barrès, qu’Einsenzweig identifie comme une étape capitale dans la montée d’une idéologie d’un genre nouveau qui prendra bientôt le nom de fascisme. L’essai d’Uri Eisenzweig occupe précisément l’espace laissé vacant dans la dizaine de pages consacrées par Estelle Anglade-Trubert à l’affaire Dreyfus : et la littérature ? Et Les Déracinés ? Nous sommes pourtant ici au cœur de l’articulation du politique et du littéraire qui traverse tout l’ouvrage d’Estelle Anglade-Trubert, pour le meilleur, et la lecture de Leurs figures comme « anti-roman » aurait pu la conduire directement à aborder enfin les problèmes extrêmement riches posés par Eisenzweig autour du « formatage (anti-)romanesque de l’antisémitisme2 » sensible en particulier, mais pas seulement, dans Les Déracinés (qui fait d’ailleurs partie de la même trilogie romanesque, Le Roman de l’énergie nationale). Mais précisément, poser cette question en thématisant l’antisémitisme de Barrès sans chercher à l’atténuer ou à réhabiliter un Barrès « injustement ignoré », cela implique de continuer d’accabler Barrès, ou au moins de reconnaître le bien-fondé de la relative infamie qui accompagne aujourd’hui son nom. Or, n’est-ce pas le prix à payer pour rouvrir cette œuvre ? Pour lire Barrès, ne faut-il pas d’abord le situer pour de bon sur le banc des accusés (en prolongeant d’une autre manière le procès Dada de 1921), plutôt que de rouvrir une énième fois le dossier de sa défense ? Procéder ainsi, ce n’est pas « oublier » Barrès, comme un critique proposait récemment de le faire avec Camus, ni « l’annuler », pour prendre un mot central des controverses culturelles contemporaines. Au contraire : il ne faut pas lire Barrès malgré son antisémitisme plus ou moins prononcé, mais à cause de celui-ci, car cette histoire littéraire-là reste encore largement à faire. Espérons qu’à l’avenir, les recherches barrésiennes emprunteront davantage cette voie critique, mettant à profit les pistes parfois très fines dégagées tout au long de l’ouvrage d’Estelle Anglade-Trubert, en les articulant à un effort théorique plus poussé, parent de celui d’Eisenzweig (plutôt sans doute que de Sternhell), et sans céder à la tentation de l’éloge ou de l’apologie, ce démon des études littéraires qui ne rend pas toujours service à ceux qu’il habite.

