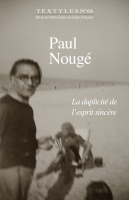
Un surréaliste insaisissable
1« Non seulement la tête la plus forte (longtemps couplée avec Magritte) du surréalisme en Belgique, mais l’une des plus fortes de ce temps », selon Francis Ponge1, Paul Nougé n’est plus un auteur confidentiel depuis les années 1950 : réédition de ses écrits par Marcel Mariën aux « Lèvres Nues » (Bruxelles), puis chez « L’Âge d’Homme » (Lausanne), Didier Devillez (Bruxelles) et d’autres éditeurs ; articles savants dans diverses revues ; biographie d’Olivier Smolders (Archives du Futur, 1995) ; thèses de doctorat ; volumineux essai de Geneviève Michel (Peter Lang, 2011), etc. De toutes ces publications se dégage, on le sait, l’image d’un intellectuel-écrivain peu com-mun, perspicace et incisif, précurseur sur bien des points, méfiant à l’égard de toute chose préten-dument établie, d’une large curiosité culturelle, sans compter un talent affirmé d’animateur. Pour-quoi la revue Textyles a-t-elle entrepris d’y revenir une fois encore ? Certes pas pour un énième panoramique ou une nouvelle synthèse. Il s’agit plutôt d’aborder certains aspects jusqu’ici peu ou pas explorés, tant de l’œuvre que de l’homme Nougé. Aspects secondaires, pourrait-on croire, mais dont l’examen dessert un projet névralgique : rectifier certaines approximations, approfondir l’extrême complexité du personnage et de l’écrivain, dont la créativité s’étayait sur de nombreux paradoxes ; et, par là, désamorcer tout risque de retombée dans une image simpliste ou réductrice.
Effacement de la figure de l’auteur
2Un trait fondamental, chez Nougé, est l’effacement de l’ego — non seulement le sien propre, comme il en a précocement pris l’habitude, mais celui d’écrivains qui le précèdent et dont il récrit partiellement certains textes. À propos des tracts de Correspondance, Maxime Thiry souligne que certains ne sont pas signés, d’autres comportant deux ou trois signatures ; et que, d’autre part, ils regorgent d’emprunts non référencés à des textes antérieurs. En deux colonnes, une comparaison entre la version de Jean Paulhan et celle de Paul Nougé montre que si la première reste identifiable dans la seconde, celle-ci constitue une effective quoique discrète subversion de la signification propre au modèle. Même procédé à propos d’un extrait du scientifique Henri Poincaré, mais ici la version nougéenne, très succincte, tient davantage du commentaire ironique. Dans tous les cas, c’est le principe même de la propriété auctoriale du texte qui se trouve mis à mal.
3Dès 1925, Paul Nougé fait œuvre de précurseur dans La Publicité transfigurée, mettant en garde contre la manipulation délétère d’objets visuels : trente ans plus tard, le texte majeur de Guy Debord, Mode d’emploi du détournement, réactivera cette stratégie, ce que montre Fabrice Flahutez. Ayant consulté notamment plusieurs lettres inédites, celui-ci peut affirmer que Nougé et Debord furent compagnons de route quelques années, en marge du surréalisme et du lettrisme, et dans une connivence que nourrissait une totale désinvolture envers les notions tenaces d’Auteur ou de Moi ; les situationnistes en seront grandement redevables. Quant à lui, Clément Dessy examine les réécritures (1930-1934) de cinq poèmes de Baudelaire, concluant qu’elles en dénaturent à dessein l’esprit et les images : c’est en quelque sorte le baudelairisme que révoque Nougé, poursuivant une entreprise de dépropriation du texte et de « déconstruction de la notion même d’auteur » (p. 87).
4Fin 1913, début 1914, Paul Nougé (18 ans) et Paulette Deschamps (22 ans) consignent dans trois carnets leurs états d’âme de jeunes amoureux. Au-delà des inévitables mièvreries et clichés, Geneviève Michel identifie avec pertinence quelques germes comportementaux qui s’amplifieront plus tard. Elle souligne notamment le recours du soupirant au sophisme quand il s’agit de minimiser son athéisme, une apologie verbale de la lutte sans grande concrétisation, un esprit brillant mais torturé, une tournure à la fois exigeante et toujours insatisfaite. Il en ressort clairement que l’action et les écrits de Nougé à partir de 1925 relèvent moins d’un vouloir sereinement délibéré que de dispositions caractérielles. Une autre disposition comportementale est mise en évidence par Paul Aron à partir des lettres que Nougé adresse à Charles Counhaye dès 1927 : le recours aux « masques », qu’il s’agisse du pseudonyme Paul Georges, de Clarisse Juranville, du compositeur André Souris et de Magritte lui-même, dont les tableaux lui ont donné à plusieurs reprises l’occasion d’expliciter ses conceptions en matière artistique.
Une stratégie de type circonstanciel
5Le dossier de Textyles met en lumière une deuxième dimension essentielle de l’attitude nougéenne : le rejet de tout dogmatisme, fût-ce sous la forme du manifeste. Fabrice Flahutez rappelle que Paul Nougé oscille sans peine entre le surréalisme et d’autres courants tels que l’Internationale Lettriste. Non seulement il refuse l’idée même d’une allégeance exclusive, mais il écarte tout projet personnel de proclamation doctrinale, au profit d’une stratégie de harcèlement. Retraçant sa longue pratique du jeu d’échecs et les commentaires qu’en écrit Nougé — lequel met l’accent sur les subtils aspects cognitifs du jeu —, Christophe Vandesavel établit un parallèle éclairant avec les modalités de son interventionnisme littéraire et de son écriture poétique : « plans » à moyen ou à long terme basés sur certaines caractéristiques de la position, « coups » visant au contraire un avantage immédiat. Relevant non du choc frontal mais de la « ruse », les tactiques nougéennes présentent un caractère foncièrement circonstanciel.
6Dans cette logique, il n’était pas vain de réexaminer les concepts d’acte, d’efficacité et leurs déterminations dans l’œuvre de Nougé, lequel affirme de façon répétée : « je suis ce que je fais, je vaux selon mes actes ». Partant de la Conférence de Charleroi, Pierre Piret montre cependant que sa conception en la matière est très ambiguë ; à l’opposé de l’intentionnel et du prévisionnel, elle tient à « un certain pouvoir d’action délibérée2 » mais non verbalisable, tentant de s’extraire du dicible pour opérer un « franchissement signifiant3 », selon les termes de Jacques-Alain Miller. Cette position théorique se manifeste constamment dans la poésie de Nougé, comme l’indique par exemple L’Amateur d’aubes, l’acte poétique étant appelé à déboucher — à condition qu’il réussisse — sur une « trouvaille » qui le justifie a posteriori. Il n’est pas le contraire du verbal, dans lequel il s’ancre pour mieux s’en extraire, et recourt souvent à une forme inhabituelle d’équivoque, car quasi assertive et non rhétorique. Face à cette conception largement spéculative, plus concrets sont les actes polémiques accomplis par Nougé, notamment lors de sa complicité avec les lettristes et Guy Debord telle que la décrit Fabrice Flahutez.
Excéder le rationalisme
7Le dossier de Textyles souligne par ailleurs trois voies par lesquelles Nougé échappe aux étroites contraintes du système cartésien : la musique, le travail versificatoire, la promotion poétique de l’errance. Geneviève Michel rappelle que, très mélomane, il assiste à des concerts, est particulièrement attiré par les voix féminines, écrit des chansons, des textes pour le compositeur André Sou-ris. Il ne s’agit pas d’un passe-temps. « J’ai toujours pensé et construit ma pensée d’une manière musicale4 », écrit-il en 1941. Quoique lapidaire, la formule est très instructive ; elle n’est pas sans rappeler la prédilection de l’auteur pour le jeu d’échecs, témoignant d’une réticence obstinée à l’égard de l’ordre du discours et de sa position culturellement dominante.
8De son côté, Gérald Purnelle examine avec précision les différents modes de versification mis en œuvre par Nougé, concluant qu’ils reposent sur deux bases fondamentales. D’une part, une élaboration de la prose orientée vers une brièveté progressivement accrue, jusqu’à l’aphorisme ou même au syntagme autonome ; d’autre part une alternance entre vers libre et vers régulier, selon le type d’expressivité jugé préférable par l’auteur. D’un point de vue davantage thématique et stylistique, Pierre Taminiaux aborde divers paysages imaginaires nougéens figurant dans L’Écriture simplifiée et La Parole est à Baudelaire. Il observe que le parcellaire et l’aléatoire jouent un rôle prédominant dans la composition de ces paysages. Ainsi le discours poétique se fait-il doublement errant par son mode de progression toujours imprévisible, par ses images insistantes de la marche et de la déambulation.
*
9Ainsi, thème par thème, s’éclaire le sous-titre insolite du numéro spécial que Textyles consacre à Paul Nougé : La duplicité de l’esprit sincère. Récrivant le texte de Jean Paulhan Jacob Cow le pirate, Nougé évoque « la duplicité de l’esprit sincère et qui, disant le vrai, voit le faux dans le même moment ». Dans sa configuration paradoxale, et jouant sur les deux sens du mot « duplicité », cette phrase subvertit l’opposition courante entre vérité et fausseté, suggérant qu’elles peuvent devenir indiscernables, voire permutables — une aporie qui traversera le siècle entier.

