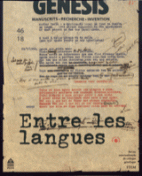
Œuvrer, écrire, penser entre les langues
1Le numéro 46 de la revue Genesis, la revue internationale de critique génétique éditée par l’ITEM (Institut des textes et manuscrits modernes, UMR 8132 CNRS/ENS), est consacré à la création « Entre les langues ». Mais bien plus qu’un simple numéro de revue, ce dossier, dirigé par Olga Anokhina et Emilio Sciarrino, dresse un état des lieux tant de la création que de la recherche dans ce champ encore peu exploré, bien que riche, étendu et complexe, de l’écriture plurilingue.
Plus qu’un numéro
2Ce numéro se distingue tant par la qualité des reproductions couleur de manuscrits inédits, laissant voir les strates d’écriture, les repentirs, les modifications et les hésitations, que par la qualité scientifique et la cohérence de l’ensemble.
3À l’exclusion des « Varia » hors dossier, dont il ne sera pas question dans ce compte-rendu, les contributions s’inscrivent dans la droite ligne des travaux menés par l’équipe de recherche de l’ITEM « Multilinguisme, traduction, création » (dirigée par Olga Anokhina), qui se consacre à l’étude du processus créatif des écrivains plurilingues et des traducteurs. L’objectif de ce numéro est de montrer que l’analyse du dossier génétique des œuvres (de l’esquisse à l’épreuve) constitue un accès privilégié à la création plurilingue. Cette approche est justifiée triplement par les responsables du numéro : d’abord, elle permet de revenir à la singularité de l’écriture, dont des travaux d’inspiration plus philosophique sur le sujet, comme ceux de Derrida, avaient pu éloigner le critique. Ensuite, elle met au jour le rôle du plurilinguisme dans la créativité de l’écrivain, ce que ni la neurolinguistique, s’intéressant à la créativité mais pas à la littérature, ni la psycho-ou la socio-linguistique n’ont su montrer. Enfin, l’approche génétique révèle l’envers d’un « monolinguisme apparent » (p. 7) : les brouillons font apparaître des jeux entre les langues, souvent effacés au moment de la publication et pourtant moteurs de création.
4La communauté de méthode – la critique génétique – n’est pas, néanmoins, le seul facteur de cohésion. L’ouvrage frappe en effet par l’alliance de deux qualités, rarement réunies dans les volumes collectifs : la variété et la cohérence. La variété, d’abord, est liée à la couverture d’un large spectre d’aires linguistiques (italien, espagnol, portugais, allemand, russe, chinois…), à l’étendue des périodes embrassées (du xixe au xxie siècle) et à la diversité des cas présentés (dialectes ; translinguisme ou changements de langue lié à immigration ; plurilinguisme favorisé par les expériences de traduction, etc.). Néanmoins, cette variété n’est pas synonyme d’émiettement ni de juxtaposition. Tout au contraire : ces études réaffirment un cadre d’analyse partagé, une terminologie convergente et un style homogène.
Thème : cadrage théorique
5L’article d’ouverture par O. Anokhina et E. Sciarrino, « Plurilinguisme littéraire : de la théorie à la genèse », présentant un panorama à la fois historique et théorique de la question du plurilinguisme, donne le la à la suite du numéro. Les auteurs commencent par remettre en question trois idées : celle selon laquelle le plurilinguisme littéraire se réduirait aux écrivains émigrés ; celle selon laquelle plurilinguisme serait limité aux xxe-xxie siècles ; enfin celle selon laquelle ce serait un phénomène marginal. En un mot, loin d’être une bizarrerie excentrique produite par une poignée de cosmopolites modernes éclairés, la littérature plurilingue résulte de situations historiques et biographiques largement partagées : de la littérature de migrants à la littérature post-coloniale, de la cohabitation des dialectes aux situations nationales de diglossie, des écrivains polyglottes à ceux dont le parcours les conduit à changer de langue. Si cette dimension plurilingue est minorée, voire occultée, c’est moins parce qu’elle n’existe pas ou peu que parce que l’idée selon laquelle la littérature serait d’abord monolingue est un héritage des États-nations et de la place de la littérature dans l’élaboration de l’identité nationale.
6Comment parler, donc, de cette littérature plurilingue ? Les auteurs répondent en trois temps : par la terminologie, par la méthodologie, et par l’identification des stratégies d’écriture, déployées par les créateurs.
7La terminologie d’abord : écartant les termes de « code switching », qui n’est que l’une des modalités de l’écriture plurilingue, de « translinguisme » et de « hétérolinguisme », qui sont issus de la recherche nord-américaine, O. Anokhina et E. Sciarrino défendent le terme de « plurilinguisme », rejoignant ainsi les préconisations européennes. Le Conseil de l’Europe parle en effet de « multilinguisme » pour décrire une situation de coexistence entre plusieurs langues dans un même pays, et réserve le terme de « plurilinguisme » à la situation linguistique d’un individu. Ce dernier terme s’applique donc parfaitement à celui qui crée entre les langues : l’écrivain plurilingue est ainsi celui « qui, lors de son écriture, utilise au moins deux langues dont on peut trouver les traces – explicites ou implicites – soit dans ses œuvres publiées, soit dans les documents de travail qui accompagnent son processus créatif » (p. 15).
8La méthodologie, ensuite: si la recherche sur le plurilinguisme trouve ses origines du côté de la linguistique, avec l’ouvrage fondateur de Uriel Weinrich, Languages in Contact (1952), et avec le concept de « polyphonie », élaboré par Bakhtine à propos de Dostoïevski, si elle a ensuite basculé du côté de la philosophie, avec les travaux de Deleuze et Guattari sur la littérature mineure et avec Le Monolinguisme de l’autre de Derrida, la génétique textuelle rompt avec ces disciplines et ces traditions pour remettre le texte, dans toute son épaisseur, au cœur de l’activité critique. Prenant pour objet les bibliothèques d’écrivains, la correspondance, les journaux et les brouillons, « offr[ant] un profil linguistique et historique de l’auteur » (p. 19), elle s’attache à décrire comment l’écrivain mobilise différents idiomes pour servir son projet esthétique et quelle est sa posture, du plurilinguisme revendiqué au monolinguisme prétendu.
9Concernant les stratégies d’écriture, enfin, les auteurs en dénombrent quatre :
10Quelle que soit la stratégie adoptée, le plurilinguisme stimule la créativité en développant la conscience métalinguistique du créateur : si, en tant que scripteur expert, un écrivain possède une intelligence verbale très développée, le fait de connaître et parler plusieurs langues la décuple. L’apprentissage de langues étrangères peut ainsi conduire à la pratique de la traduction, et peut aller jusqu’à l’invention d’une langue, comme le montre l’exemple récent de Frédéric Werst dans ses Wards1.
Variations : études de cas
11Cet article de cadrage théorique est suivi de six études, puis de deux inédits qui présentent des manuscrits non publiés.
12Dans « Monolinguisme, plurilinguisme, translinguisme. À propos de la genèse du poème « Huhediblu » de Paul Celan », Dirk Weissmann montre que le monologuisme apparent de Paul Celan masque un plurilinguisme biographique et créatif. D’un point de vue biographique, Celan est un poète germanophone d’origine roumaine naturalisé français, qui traduit du russe, de l’anglais, de l’italien, de l’espagnol, de l’hébreu, du portugais. D’un point de vue créatif, son « processus d’écriture » montre que « les langues se rencontrent pour s’influencer » (p. 37) : ainsi, dans un cahier préparatoire, Celan transcrit un vers de Essénine en russe, qu’il commente en français, tout en glissant des extraits de traduction allemande et une citation en latin. Dans le recueil Niemandsrose (La rose de personne) publié en 1963, et plus particulièrement dans son poème « Huhediblu », le poète joue avec une « forme complexe d’intertextualité hétérolingue » (p. 40) : Dirk Weissmann montre en effet que « Huhediblu » absorbe et transforme cinq citations de cinq poèmes, de langues française, anglaise et allemande. Cette « appropriation transformatrice » (p. 45) affecte à la fois le sens et la forme sonore des originaux : Celan réinterprète par exemple la floraison d’un poème de Verlaine (« Oh quand refleuriront les roses de septembre ») en associant les fleurs à la mort à travers une série de jeux phoniques, sémantiques et syntaxiques entre le français et l’allemand, afin de mieux mettre en évidence le caractère meurtrier du langage, dans le contexte de l’après Seconde Guerre Mondiale. Ce travail poétique témoigne d’un véritable « espace de création entre les langues » (p. 48), dont le « titre hybride » (p. 48) du poème porte la trace.
13Dans « Tisser le texte et cacher les fils : l’écriture plurilingue de Manuel Puig », Delfina Cabrera insiste sur l’originalité de la position de Manuel Puig, et sur l’importance de son plurilinguisme caché dans l’élaboration d’une esthétique singulière. Dans les années 60‑70, deux positions s’opposent alors en Amérique latine : écrire en espagnol des œuvres portant la vision d’une communauté latino-américaine unifiée au-delà des frontières nationales, ou bien écrire dans une langue autre, pour s’éloigner de ce pan-latinoaméricanisme. Or Puig trace une troisième voie, puisque, bien qu’écrivant en espagnol, il met en oeuvre des « stratégies créatives qui appellent à la cohabitation, à la recomposition et à la transformation mutuelle des langues » (p. 52). C’est sa connaissance des langues étrangères qui permet à Puig de malmener l’espagnol et de le miner de l’intérieur pour mieux désacraliser la grande littérature et ses normes langagières. À l’étape pré-rédactionnelle, d’abord, il pratique le code switching, passant constamment de l’espagnol à l’anglais, qu’il réserve aux commentaires métatextuels, tout en insérant ponctuellement du français, de l’italien, du portugais, et des mots de l’idiolecte familial (déformation de l’espagnol). Lors de la phase de textualisation, ensuite, Puig ne conserve plus que l’espagnol et l’anglais : il traduit ses textes de l’espagnol en anglais, puis corrige la version espagnole d’après l’anglais, puis la version anglaise d’après cette première correction de l’espagnol, et enfin les deux versions parallèlement et identiquement.
14Dans « Les deux langues en clair-obscur dans Mimodrames et Icônes de Juan Mari Lekuona », Aurélia Arcocha-Scarcia rappelle d’abord la situation des langues dans l’Espagne post-franquiste : la récente diglossie, le basque étant devenue langue officielle en 1982, favorise la pratique de l’autotraduction. Les écrivains basques y restent néanmoins hostiles, qu’ils se montrent défiants vis-à-vis du recours à la langue majeure ou qu’ils considèrent l’autotraduction comme une « perte de temps» (Miguel del Toro, cité p. 66). C’est sans doute la raison pour laquelle Juan Mari Lekuona, poète, universitaire et traducteur d’expression basque, dissimule sa pratique de l’autotraduction en castillan, qu’il considère comme un moyen d’« améliorer la qualité esthétique du texte» (cité p. 67). Les poèmes sont composés d’abord en basque et en vers, avant d’être autotraduits en espagnol en prose ; cette transposition souligne, à elle seule, le fait que le passage par l’autre langue et l’autre forme constitue un « facteur de distanciation » (p. 68) efficace avec son propre texte permettant de l’améliorer. Au fil des réécritures successives, la version en basque comme la version en espagnol sont chacune retravaillées. La chercheuse observe donc comment les modifications apportées à un texte dans une langue produit de nouvelles corrections dans l’autre langue. Mais elle fait également remarquer que l’espagnol disparaît peu à peu des brouillons pour ne laisser que la version en basque, d’ailleurs seule publiée : dans le cas de Lekuona, l’autre langue, l’espagnol, ne sert que de miroir destiné à polir le texte en basque.
15Dans « Aperçus d’une genèse bilingue chez Jean-Joseph Rabearivelo », Claire Riffard présente un cas singulier d’écriture bilingue simultanée. Le contexte dans lequel Ribearivelo, jeune poète malgache, commence à créer est marqué par la violence coloniale et la domination du français, devenu langue officielle à Madagascar en 1896, quoique sur fond de plurilinguisme (variantes régionales du malgache, langues européennes importées au xixe siècle par les missionnaires anglais, etc.). Ribearivelo s’approprie le corpus de la grande poésie française, pour y apporter à son tour une importante contribution : son premier recueil, publié en 1926, La Coupe de cendre, est salué en France par des écrivains de premier rang. Néanmoins, Ribearivelo poursuit en parallèle une œuvre de poète, dramaturge et théoricien en langue malgache, qui semble autonome par rapport à ses productions en français. Or l’étude du brouillon de Presque-Songes montre que le bilinguisme est en réalité à la source de toute sa création en français : sur un cahier A5 recto-verso, l’écriture en deux colonnes déploie la version malgache à gauche et la version française à droite. Le trait séparant les deux langues est d’abord au centre, puis, à partir du quatrième poème, est tracé à la main et suit la version malgache. Ce document atteste d’une écriture conjointe, simultanée en deux langues, dont seule la version française sera publiée en 1934. L’écriture simultanée s’accompagne d’interférences et de « contamination » (p. 87), à la fois syntaxiques, lexicales et rythmiques, entre deux imaginaires, deux univers culturels, deux langues très éloignées. Ainsi, les deux langues s’interpénètrent continûment, dans « la négociation permanente entre leurs irréductibles frontières » (p. 91).
16Dans « Remarques sur la création plurilingue chez Fernando Pessoa », Joao Dionisio montre que le plurilinguisme de Pessoa, loin de se réduire à des citations éparses dans plusieurs langues, s’étend non seulement aux annotations métadiscursives en marge de ses brouillons, souvent en anglais, mais aussi à la composition poétique. Après avoir rappelé que Pessoa, qui a appris l’anglais et le français à l’école en Afrique du sud, ambitionne d’abord de devenir un écrivain de langue anglaise, l’auteur met au jour une relation complexe entre les trois langues du poète : le portugais, l’anglais et le français. Ainsi, le poème « O Marinheiro » est d’abord composé en français, avant que Pessoa ne revienne au portugais, à défaut, sans doute, de parfaitement maîtriser son outil. Le premier exemple analysé rend en effet visible le fait que Pessoa change de langue parce qu’il ne parvient pas à trouver le mot juste en français. Néanmoins, si elle n’a été qu’une étape, l’écriture en français a stimulé la création poétique en portugais.
17Dans « Les brouillons “entre les langues” de Raoul Hausmann », Agathe Maureuge commence par rappeler que le mouvement Dada, auquel appartenait Raoul Hausmann, était intrinsèquement plurilingue : les artistes et poètes Dada, de toutes les nationalités (allemands, français, suisses, autrichiens, roumains, italiens), ont cherché à opposer aux boucheries de la guerre l’art et le langage, en recourant au non-sens, à la subversion et à la provocation. Les dadaïstes écrivent en plusieurs langues car cela fait partie de l’attaque contre une conception classique, bourgeoise et nationaliste de la littérature. Né à Vienne en 1886 et membre majeur de ce mouvement, Raoul Hausmann écrit donc des pamphlets contre l’Allemagne, ce qui le contraint à s’exiler en 1933 à Ibiza, qu’il quitte pour la Suisse, puis pour la Tchécoslovaquie, et enfin pour Paris, d’où il déménagera pour le Limousin où il s’installe définitivement à partir de 1971. Ce parcours qui l’a conduit jusqu’en France explique que son œuvre tardive témoigne du désir de devenir auteur français tout en continuant à écrire en allemand. Deux dossiers génétiques sont analysés par Agathe Maureuge. Il y a, d’abord, le « courrier Dada », projet dont l’ambition est de raconter ce que fut Dada à Berlin au moyen de documents historiques (manifestes écrits ou co-écrits entre 1918 et 1921), est composé d’abord en allemand, en 1939 ; puis, ne trouvant pas d’éditeur, Hausmann commence à s’autotraduire en français à partir de 1945, et poursuit la rédaction en français, tout en continuant à rédiger une version en allemand, jusqu’en 1956. Le deuxième dossier génétique étudié est celui de Hylé, un « ensemble composé, hybride, un assemblage de fragments» (p. 109) dont la rédaction s’étale de 1926 à 1950 : Hylé 1 porte sur les années 1926‑1933 en Allemagne, et Hylé 2 sur les années 1933‑1936 à Ibiza. Ce texte demeure inachevé : au fil de années, des demandes des éditeurs, des traductions et des révisions, Hausmann ne cesse de couper, d’insérer, de réagencer sans fin. Or cette mobilité de l’écriture s’exprime également par le passage d’une langue à l’autre, le yiddish, le français, l’anglais, l’espagnol, l’ibizenco se côtoyant : « par cette écriture plurilingue, le poète entend libérer le langage du carcan grammatical et syntaxique qui l’emprisonne dans chaque langue » (p. 110). Au-delà d’un plurilinguisme réaliste, servant à transcrire les dialogues des habitants cosmopolites d’Ibiza, le plurilinguisme de Hausmann s’inscrit surtout dans la recherche d’une écriture « optophonétique », au plus près des sensations, des impressions corporelles et sensorielles, qui reflète et incarne l’attention portée à la matière (« hylé » signifie la matière primordiale en grec), dans laquelle la vie et le langage s’unissent.
18Dans « Le dualisme de Dionysos Solomos. L’italien et le grec dans la genèse des Libres Assiégés », Kostis Pavlou évoque l’œuvre de Dionysos Solomos, poète grec majeur du xixe siècle (1798‑1857), dont « L’Hymne à la liberté» est devenu l’hymne national grec. À travers l’analyse des brouillons de trois pages inédites des Libres Assiégés, Kostis Pavlou décrit avec précision la place de l’italien dans la création du poète. Son bilinguisme ne s’explique pas seulement par la situation biographique du poète (puisqu’il s’est formé en Italie du lycée à l’université), mais aussi par la situation historique et sociale des îles Ioniennes. Sous l’autorité de la République de Venise de la fin du xvie siècle à 1797, celles-ci sont marquées par la coexistence des deux langues, même si le grec gagne peu à peu du terrain après que l’italien a perdu son statut de langue officielle en 1852. Les Libres Assiégés (composés entre 1834 et 1844) correspond à sa période de maturité, quand Dionysos Solomos écrit en grec (et non plus en italien comme dans sa jeunesse), mais les interférences avec l’italien restent nombreuses. Non seulement l’italien est utilisé pour les commentaires métadiscursifs, endossant un « rôle scénaristique » (p. 133), mais le grec est influencé par l’italien au niveau graphématique-phonétique (emploi de caractères latins au sein des mots grecs), morphosyntaxique, lexical, sémantique et métrique. Kostis Pavlou montre en effet que certains vers de Dionysos Solomos sont en réalité des transpositions de vers grecs en italien. Le bilinguisme profond de l’œuvre du poète grec est néanmoins occulté, sans doute en raison de la place de Solomos dans la construction de l’État-nation, suite à l’indépendance.
19Dans « Giuseppe Ungaretti et le processus de création circulaire. La genèse de Gridasti : soffoco », Emilio Sciarrino développe l’idée que l’oeuvre plurilingue déjoue la clôture de l’écriture. En effet, les diverses étapes de rédaction, traduction, réécriture, retraduction s’inscrivent dans un « processus d’écriture circulaire » (p. 145), qui relance à l’infini la création. Giuseppe Ungaretti publie dans le journal Popolo en 1950 le poème « Gridasti: soffoco », qui raconte à la fois la douleur des guerres du xxe siècle et la douleur intime de la perte d’un être cher (son jeune fils). Robert O. J. Van Nuffel, professeur d’italien à l’université de Gand, découvre le poème et s’engage dans sa traduction. Après un échange de lettres avec Ungaretti qui commente la traduction et apporte un certain nombre de corrections (ajout, modification d’adverbes, adaptation stylistique, travail de nuance sur les substantifs), la traduction est publiée en février 1950 en revue, sans que Van Nuffel n’ait pris en compte les trois dernières lettres de Ungaretti. Influencé par son travail sur la traduction française qui l’a laissé insatisfait, Ungaretti remanie le texte en italien entre 1950 et 1952, mais cette fois la réécriture est orientée vers la traduction à venir, comme s’il s’agissait d’augmenter la traduisibilité du texte, et de contrôler ainsi la marge d’action du traducteur. Ungaretti contacte Jacottet pour assurer la traduction française du poème dès 1951, mais celle-ci tarde venir (elle ne sera publiée qu’en 1970). Ungaretti se tourne alors vers Jean Lescure, avec qui il traduit le poème qui paraît dans le recueil Les Cinq Livres : « la genèse de ce poème est représentative du processus d’écriture bilingue de Guiseppe Ungaretti qui mettait le texte poétique à l’épreuve par un jeu de reflets, de variantes et de modulations en deux langues » (p. 158), conclut Emilio Sciarrino.
Paroles d’écrivains
20Le dossier de la revue se termine par deux entretiens, l’un avec l’auteur chinois écrivant en français Gao Xinjian, et l’autre avec l’écrivaine et universitaire d’origine russe, Luba Jurgenson. Les échos sont nombreux entre ces deux entretiens qui se répondent et se complètent : l’un et l’autre évoquent la dimension corporelle de la traduction et du rapport à la langue, l’expérience infiniment reconduite de l’écart entre deux langues et deux expériences du réel, l’autotraduction conçue comme recréation et non comme un simple passage d’une langue dans une autre, etc.
21Gao Xingjian, dont les propos sont recueillis par Simona Gallo, raconte comment il en est venu à écrire en français : au début des années 90, le ministère de la Culture lui commande une pièce de théâtre. Gao Xingjian décide de l’écrire en français, car il lui semble inconcevable de s’adresser à un public, au théâtre, dans une langue étrangère. Puis, comme il réside en France et qu’il voit son oeuvre interdite en Chine, il continue à écrire en français, sans abandonner pour autant le chinois, ni ressentir l’une ou l’autre langue devenir dominante : « J’ai une pensée chinoise, j’ai une pensée française. Je les connais assez bien toutes les deux. Et entre les deux, il n’y a pas d’opposition entre une pensée dominante et une pensée assimilée » (p. 119). En effet, le français se situe, pour lui, du côté de la rationalité et de la précision (de ce fait, cette langue est parfaitement adaptée aux écrits théoriques), alors qu’en chinois domine « la non-dualité permanente» (p. 119), la possibilité de penser les contraires dans le même mot. C’est pourquoi Gao Xingjian considère l’autotraduction comme impossible. Il est impossible, dit-il, de passer d’une langue à l’autre sans tout recréer car « il faut trouver ce qui est déjà dans la langue, en germe » (p. 117) : écrire, pour lui, c’est donc d’abord écouter la langue.
22Luba Jurgenson, dont les propos sont recueillis par Julia Holter, raconte qu’ayant quitté la Russie à 17 ans, elle a, lorsqu’elle s’exprime en russe, la sensation de revivre physiquement ses 17 ans, non que son russe soit limité, mais son corps a cessé de vivre dans cette langue à la fin de l’adolescence. Le français a comme peu a peu remplacé cette peau première : « progressivement, j’ai senti qu’en français, mes mots, je les « avais dans la peau », comme dit l’expression populaire, parce que d’une certaine manière, j’avais changé de peau » (p. 122). Elle fait le parallèle avec des artistes « bilingues », au sens où ils ont pratiqué deux arts, qui en ont finalement sacrifié un pour développer la pratique de l’autre. Cette définition étendue du bilinguisme ne touche pas seulement les arts, mais aussi ce que Jurgenson appelle les « petites langues » – dialectes, sociolectes, idiolectes familiaux, etc. L’entretien est dense et riche : il entrelace les récits d’expériences de l’appréhension de la langue étrangère et les réflexions sur la traduction et l’écriture entre les langues. On peut ainsi citer l’expérience de la « phase magique », au moment où l’on commence à apprendre une langue : la « phase de rencontre et de reconnaissance avec les mots» (p. 122) rend certains vocables merveilleux, comme le fut « astringent » (p. 123) pour Jurgenson. On peut également citer les réflexions suscitées par la traduction croisée avec l’écrivain Leonid Guirchovitch : celui-ci, séduit par le roman de Luba Jurgenson Education nocturne, lui propose de le traduire en russe ; cette traduction russe, à laquelle elle a collaboré, a été pour l’écrivaine l’occasion de réécrire le livre, de rééquilibrer le ton et le poids des mots, au point qu’il lui est impossible de décider laquelle des deux versions est un original : « la traduction russe est plus ouvertement postmoderne que l’original français […] ou la traduction russe plus postmoderne que la traduction française, car au fond, il n’y a plus d’original du tout » (p. 126). À l’inverse, lorsqu’elle a traduit en français le livre Schubert à Kiev de Leonid Guirchovitch, le défi a été de trouver le moyen de transposer les passages en ukrainien au sein du texte russe. Refusant de simplement choisir arbitrairement un dialecte ou une langue régionale française, elle a trouvé une solution originale : elle a traduit l’ukrainien en vers d’opéra puisque l’action se déroule précisément à l’opéra de Kiev. Même si elle distingue la traduction de la création, on comprend pourquoi Jurgenson insiste sur le fait que la non équivalence entre les langues produit un « jeu mental », la possibilité d’une réinvention continuée, un « réservoir d’images pour décrypter le monde » (p. 124).
***
23La lecture de ce numéro de Genesis s’impose pour qui veut penser le plurilinguisme en littérature, car il marque à la fois un bilan et une ouverture. D’abord, le bilan : non seulement il retrace l’histoire des approches critiques du plurilinguisme en littérature, mais il dresse un état des lieux complet de ce que la génétique textuelle a à apporter dans ce domaine, à travers des études de cas nombreuses et variées. L’ouverture, ensuite: ce numéro constitue un appel à modifier les perspectives sur la littérature, en sortant du cadre national, à ouvrir les corpus à des oeuvres nouvelles, mais aussi à réexaminer des oeuvres canoniques moins unilingues qu’on ne le pense.

