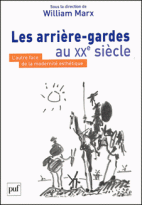
Pourquoi faut-il être absolument moderne ?
1Dans son analyse de cette « littérature restreinte » dont le dépouillement des intitulés inscrits au fichier central des thèses donne le spectacle, Michel Murat faisait récemment remarquer que les chercheurs privilégient non seulement une représentation convenue de la littérarité, négligeant de ce fait le champ de la diction (c'est-à-dire de la littérature en tant qu’elle est « coextensive à l’exercice de la pensée »), mais obéissent de plus à un impératif d’ordre idéologique « l’ancrage à gauche des idées reçues dans le monde intellectuel » :
Les écrivains qui ont eu le malheur de faire le voyage de Weimar, ou que l’on peut suspecter de tendances analogues, ne s’en sont pas relevés. Un bon exemple est celui de Marcel Arland, ami de Paulhan qui l’a proposé pour diriger les pages culturelles de Comoedia pendant l’Occupation, et dont l’attitude n’a jamais été mise en cause (sinon par Claude Morgan et d’autres communistes). Romancier, nouvelliste, critique, essayiste, Arland est typique de la mouvance NRF sur son versant académique : à l’Université, il semble qu’il figure encore sur quelque liste noire. À droite, ce qui émerge, ce sont les pamphlétaires, Céline en tête (et aussi Rebatet) ainsi que le courant des Hussards (grâce aux travaux de Marc Dambre). La valorisation des avant-gardes et des esthétiques de rupture joue également contre les écrivains conservateurs, académiques ou mondains : Bourget et Boylesve, malgré leur grande notoriété, au début du siècle, Lacretelle (malgré la NRF) ou Pierre Benoit dans les années trente, plus près de nous Armand Lanoux ou François Nourissier1.
2On jugera peut-être que la liste des thèses en cours ou des thèses déjà soutenues n’est pas un indicateur assez fiable de l’état actuel de la recherche. Il y a cependant tout lieu de penser qu’elle en révèle les tendances de fond et en accentue les défauts, renchérissant de ce fait sur un canon déjà bien établi et restant désespérément aveugle aux importantes lacunes de notre représentation commune de la littérature.
3Il y a là l’équivalent, dans le domaine des études littéraires, de ce que Thibaudet identifiait, dans le domaine de la production littéraire, comme un « avant-gardisme chronique ». Un avant-gardisme dont les effets sont d’autant plus puissants que nous font défaut les concepts qui nous permettraient de nous faire une idée plus objective de l’histoire des lettres. Le concept d’« arrière-garde », avancé par William Marx au cours d’un colloque organisé à l’Université Lyon III-Jean Moulin en mai 2003 et publié sous le titre : Les Arrière-gardes au xxe siècle, est peut‑être l’un d’entre eux.
4Inutile de cacher ce que ce concept peut avoir, au premier abord, d’insatisfaisant : bien moins usité que son antonyme, avant-gardes, il ne jouit pas de la légitimité que l’on pourrait attendre d’une notion destinée à explorer ce que W. Marx nomme : « l’autre face de la modernité ». Il y avait bien d’autres manières de désigner cette dimension jusqu’ici délaissée. Ainsi pouvait-on parler de cette « littérature académique » dont la place (institutionnelle, intellectuelle et littéraire) est largement sous-estimée dans les histoires de la littérature, attachées à suivre la ligne de crête de la production la plus innovante ou la plus marquante, de la « critique de droite », récemment étudiée au cours d’une journée d’études à l’Université Paris IV (« La critique de droite : une autre avant-garde ? » : les actes en seront prochainement publiés par Marie Gil dans la Revue d’histoire littéraire de la France), ou encore de l’« histoire des minores », que Marc Dambre (encore) a largement contribué à développer. Sans oublier la tradition de l’anti-intellectualisme, à laquelle Antoine Compagnon a consacré un article dans le n° 128 de la revue Le Débat (« Péguy antimoderne »), ou un courant politique et culturel semblable à celui de l’Action française, si puissante durant la première moitié du siècle. À défaut de choisir des objets de réflexion aussi aisément identifiables, le concept de « Maintenance », avancé par Jean Paulhan dans Les Fleurs de Tarbes, permettait de désigner avec précision cet envers de la Terreur théoricienne. Bref, les voies d’approche plus consensuelles ne manquaient pas.
5Parler d’arrière-garde permet toutefois de se saisir l’un des impensés les plus importants de ce que l’on pourrait appeler notre « imaginaire de la littérature » : celui qui nous conduit à toujours envisager l’histoire des œuvres écrites en fonction d’une dynamique orientée. Il ne s’agit pas de prendre simplement le contre-pied d’une évidence si aveuglante qu’on ose à peine en questionner la pertinence, mais plutôt de se demander si l’on peut simplement passer, ainsi que l’écrit W. Marx, de l’injure au concept. Ou encore de se demander si l’envers du concept d’avant-garde, dont on ne s’est jusqu’ici servi qu’afin de stigmatiser toutes les formes de (supposée ?) stagnation ou régression politique et esthétique (ces deux dimensions étant à chaque fois indissociables) n’offre pas une voie de renouvellement pour une histoire littéraire plus attentive à ses propres présupposés théoriques autant qu’idéologiques. Ainsi la littérature académique ou l’étude des minores, dont les implications nous sont plus familières (même si ces domaines restent encore largement à explorer), peuvent‑elles entrer dans le champ ouvert par le concept plus original d’arrière‑garde. Envisagés sous cet angle, nos cadres d’appréhension du fait littéraire trahissent leurs imperfections ; il devient possible de mettre au jour les marges de notre grand récit de la littérature.
6Bien sûr, une telle approche n’est pas sans un certain coût : elle nous oblige à en rabattre sur l’ambition d’homogénéité et d’intelligibilité à laquelle nous pouvons légitimement aspirer. Privée de l’idée régulatrice d’avant-garde, ou plutôt complétée et complexifiée par le concept d’arrière-garde, l’histoire littéraire ne se déroule plus avec l’uniformité et la simplicité qu’on peut lui trouver lorsqu’il n’est question que de poursuivre le projet d’une inlassable modernité vers laquelle tendraient toutes les écoles, tous les mouvements qui se sont succédé depuis près de deux siècles, du romantisme jusqu’à Tel quel — et au‑delà.
Les « arrière-gardes » : concept opératoire ou catégorie d’histoire littéraire ?
7À défaut de pouvoir résumer chacune des quinze communications qui composent le volume, nous tenterons de les présenter de manière synthétique en examinant ce qui nous paraît être le principal point de divergence entre les différentes contributions. Cette ligne de partage nous permettra de saisir les deux grandes fonctions qu’exerce d’ordinaire le concept d’arrière‑garde.
8On observe, en effet, dans le recueil un continuel va-et-vient entre deux grandes options qui, sans être tout à fait inconciliables, révèlent la très grande labilité d’une notion à laquelle certains intervenants ont choisi de donner un sens faible, de manière à en faire un concept purement opératoire, ou au contraire un sens plus fort, au point d’en faire une catégorie destinée à circonscrire un phénomène historique (mouvement littéraire, sensibilité politique, théorie esthétique, etc.) en vue de le critiquer ou au contraire de le réhabiliter — ne serait‑ce qu’en partie.
9La première option consiste à ne voir dans la notion d’arrière-garde qu’un simple outil conceptuel permettant de s’interroger sur certains points d’histoire littéraire. La réflexion de Jean-Pierre Esquenazi sur « Arrière-garde et Nouvelle Vague : le cinéma "qualité française" » en est un très bon exemple. L’hypothèse développée est la suivante : « il n’y a arrière-garde que s’il y a concurrence dans le champ de l’art » (p. 69). Adoptant un point de vue sociologique, J.‑P. Esquenazi voit dans cette dénomination un instrument de disqualification dont François Truffaut et les Cahiers du cinéma ont fait un usage si efficace que les condamnations lancées à cette époque s’appliquent encore de nos jours. Après avoir rappelé la lutte menée par les Cahiers du cinéma pour hausser certains cinéastes au statut d’auteurs, J.‑P. Esquenazi souligne qu’en devenant eux-mêmes artistes, les « jeunes trucs » ont donné toute sa force à leur campagne de dénigrement d’une « certaine tendance du cinéma français » (titre de l’article de François Truffaut dans le numéro de janvier 1954 des Cahiers du cinéma), c'est-à-dire d’une tradition réaliste dont ils dépréciaient le psychologisme de convention. Truffaut dénonça notamment l’importance en France des adaptations, dont les deux scénaristes les plus emblématiques furent Pierre Bost et Jean Aurenche. Aux yeux de J.‑P. Esquenazi, il importe à présent de relativiser cette critique d’une « tradition de la qualité », tant il est vrai que nombre des films de label « qualité française » apparaissent de nos jours encore comme des classiques, au même titre que ceux des auteurs « Cahiers » :
De ce point de vue, le jugement de l’histoire donne tort à Truffaut ; cependant, et sans que cela semble contradictoire, il est admis que le cinéma français renaît avec le cinéma de la Nouvelle Vague, que Les quatre cents coups et À bout de souffle sont les marques les plus évidentes de cette régénération. (p. 75)
10Comment expliquer une telle contradiction ? « Pourquoi a‑t‑on aussi facilement accepté d’appeler le monde cinématographique français une “arrière‑garde” ? » J.‑P. Esquenazi voit trois raisons à cela : le pessimisme propre au cinéma d’après-guerre, son silence sur les questions politiques et son éloignement du monde contemporain — « c’est une image convenue de la France traditionnelle qui [y] modèle les attitudes, les décors et les styles de parole » (p. 77). La dévalorisation critique de ce cinéma serait avant tout due au fait qu’on y proposait une image repoussante de la modernité.
11À l’opposé de la réflexion de J.‑P. Esquenazi, on trouve une série de communications appliquant au contraire la notion d’arrière-garde à différentes composantes de l’histoire (auteur, mouvement ou courant de sensibilité). L’un des exemples les plus intéressants est proposé par Jean‑François Louette dans son article sur Roger Nimier : « Hussard d’arrière-garde ». Ayant souligné la très grande rapidité avec laquelle l’œuvre de Nimier s’est trouvée intégrée à l’histoire de la littérature (Gaëtan Picon distinguait ainsi dans son Panorama deux lignées représentatives d’une littérature traditionnelle : une lignée balzacienne, où se trouve Simenon, et une lignée stendhalienne, représentée par Marcel Aymé ou Nimier), J‑Fr. Louette décrit la « panoplie d’arrière-garde » du jeune écrivain. Ce « Radiguet de la seconde après-guerre » prône, contre le culte de l’originalité, un retour à un classicisme emprunt de romantisme et dont les principales caractéristiques se définissent par un même geste de refus : refus de la théorie, refus d’appartenir à son temps, refus de la politique. L’œuvre de Nimier est emportée par un « mouvement rétrograde fondamental » (p. 167) débouchant sur une esthétique de la nonchalance dont on peut repérer trois variantes : la nonchalance lente, ou négligence, la nonchalance vive, ou insolence, la nonchalance tempérée, ou désinvolture. Chez Nimier, éthique et esthétique s’unissent en une posture mêlant le cynisme au romantisme, posture qui prête le flanc à la critique, mais qui n’en représente pas moins un certain rapport à la langue, comme le souligne très justement J.‑Fr. Louette :
L’œuvre de Nimier, malgré tout le goût que j’ai pour elle, je serais parfois tenté de la juger mineure selon un modèle à la fois géographique et chronologique. Mineure parce que respectueuse, malgré toute son affectation d’insolence, c'est-à-dire se vouant à majorer une langue déjà grande, à cultiver une langue qui aurait plutôt besoin qu’on la viole un peu ? Mineure aussi parce que s’emprisonnant dans le passé de la littérature française ? Dans la terre où pousse la langue de France, selon un mouvement de reterritorialisation ? (p. 177‑178).
12Un tel effort de reterritorialisation ou plutôt de continuelle vérification et réassurance de ce qui fait la nature même de l’identité française (la terre, les traditions, l’idéal de clarté…) n’est en rien secondaire. Le négliger comme s’il ne s’agissait que de scories de l’histoire, c’est tirer un trait sur un phénomène qui dépasse de loin les quelques domaines que nous avons l’habitude de ne considérer qu’avec une certaine condescendance — ainsi du peu d’intérêt que suscitent la littérature régionale ou de la littérature académique par exemple.
13Toutefois, la majorité des interventions oscillent entre ces deux options, sans réellement choisir. Le concept d’arrière-garde sert alors d’outil d’appréhension d’un domaine dont on ne sait s’il constitue un véritable objet de savoir, historiquement avéré, ou s’il n’est qu’une manière renouvelée d’envisager une période ou un espace littéraires donnés. C’est le cas notamment, au tout début de l’ouvrage, de l’étude tout à fait essentielle de Vincent Kaufmann : « L’arrière-garde vue de l’avant ». L’auteur de Poétique des groupes littéraires : avant-gardes 1920-1970 (PUF, 1997) s’y propose de déduire a contrario les principes de l’arrière-garde. Ce qui implique de donner au concept‑repère son sens le plus strict :
Dans la perspective qui est la mienne, l’avant‑garde, ce n’est pas un goût plus ou moins explicite pour le « moderne », mais un projet explicite et en général collectif, impliquant pour cette raison une esthétique communautaire, de dépassement de l’art, un projet anthropologique global de réalisation de l’art dans la vie (c’est par exemple le projet du surréalisme ou du situationnisme), ou du moins de refonte des diverses spécialisations intellectuelles ou artistiques (ce serait le cas des formalistes russes ou de Tel Quel). (p. 24)
14L’avant-garde ne se réduit donc pas à l’avant-gardisme pas plus qu’elle ne se dilue dans le modernisme. Ainsi défini, ce concept permet de circonscrire, par contraste, son envers : les arrière-gardes refusent l’idée d’un « sens de l’histoire », se réclament du nationalisme, pratiquent l’anti-intellectualisme, s’efforcent de préserver les communautés « naturelles » (contre les avant-gardes inventant jusqu’au vertige de nouvelles communautés politiques et esthétiques), privilégient enfin les médiums les plus populaires, notamment le roman, bête noire des avant-gardes. L’analyse de V. Kaufmann repose, on le voit, sur l’hypothèse théorique d’une sorte de complémentarité entre les deux pôles du champ intellectuel : l’un n’est que la face de l’autre. Si cette méthode se révèle fructueuse en ce qui concerne les aspects politiques et esthétiques de la question (la faiblesse des arrière-gardes est surtout d’avoir « fait l’impasse sur l’individuation ou la singularisation de l’expression au nom d’un refus du “sens de l’histoire”, au nom d’une communauté antérieure, disparue ou en train de disparaître », p. 272), elle ne permet toutefois pas de saisir parfaitement la complexité des faits considérés, qu’elle n’approche que par un jeu d’antithèses. Ainsi le critère de l’anti-intellectualisme paraît-il moins convaincant. On ne saurait nier, bien sûr, l’importance, depuis l’affaire Dreyfus, d’un discours de haine contre l’abstraction, la théorie ou la figure de l’intellectuel. N’est-il pas toutefois excessif de supposer que les postures, les gestes et les pratiques médiatiques qui appartiennent à la panoplie de l’intellectuel relève exclusivement du registre de l’avant-garde et que l’arrière-garde a, pour sa part « toujours été privée d’un certain théâtre intellectuel » (p. 32). Publié en 1941, Notre avant-guerre de Robert Brasillach avait précisément pour but de mettre en évidence l’existence d’un « esprit fasciste », que l’auteur confondait avec les proches de L’Action française et de Je suis partout, ces lieux de formation privilégiés d’un « esprit préparatoire à ce qu’on pourrait appeler le “fascisme” français » et dont Brasillach entendait bien faire la véritable « aventure intellectuelle de l’avant-guerre3 ». Ces Mémoires dressaient ainsi un inventaire complet des signes distinctifs d’une posture concurrente de celle qu’avaient adoptée Gide, Malraux ou Aragon durant les années trente : des lieux, des auteurs ou des artistes fétiches, des pratiques comme le pèlerinage en Allemagne ou en Italie, des dates (le 6 février), des goûts enfin, que les tenants de cette arrière-garde pouvaient partager avec leurs ennemis, comme celui du cinéma (« Les Ursulines, le Ciné-Latin, le Vieux-Colombier, tels ont été les temples du cinéma à cette époque. Et je serais tout prêt d’admettre que celui-là n’a pas connu le cinéma, qui n’a pas connu ces salles des temps héroïques, où montaient, comme des fumées, les vertigineuses images grises, où tout était oublié des bruits de la terre4. ») Il y a bien un « théâtre intellectuel » réactionnaire ou d’arrière-garde : simplement nos histoires littéraires n’en gardent en général pas trace.
Les paradoxes de la modernité
15La distinction entre avant et arrière‑gardes ne s’avère, en réalité, pas aussi facile à établir qu’on pourrait le penser. Il semble que différents objets d’étude ne puissent être saisis entre les pincettes de ce couple notionnel. Considérons l’exemple de l’opéra, et plus précisément de l’opéra wagnérien, dont Thimothée Picard livre une passionnante analyse : les lignes de partage qui séparent le progrès de la réaction se révèle dans ce cas totalement inefficaces. Durant la période 1875-1925 coexistent ainsi des conceptions contradictoires de la nature esthétique et politique de ce genre. L’hypothèse est la suivante :
L’indécidabilité idéologique, intrinsèque à l’opéra, tient de son mode de fonctionnement même, qui a toujours été de créer en imitant, d’aller de l’avant en se référant à l’ancien — celui des Grecs. (p. 52)
16L’œuvre de Wagner en est la parfaite illustration puisqu’y voisinent « une vision téléologique dynamique, fortement vectorisée par l’idée de l’avenir d’une part, et au sein de laquelle le Héros (Siegfried) serait l’agent susceptible de régénérer le devenir humain en proie à la déréliction ; et une vision circulaire d’autre part, celle des cycles du vouloir-vivre tout autant que du ressassement mémoriel du mythe de l’éternel présent de la célébration populaire, vision au sein de laquelle non plus le Héros, mais le Pur (Parsifal), permettrait perpétuellement l’avènement à soi-même et pour soi-même du “fictionnement” de la collectivité » (p. 53). Cette Weltanschauung ambiguë a permis les lectures les plus contradictoires, notamment chez Nietzsche, qui vit en l’opéra wagnérien l’œuvre de l’avenir par excellence, puis la manifestation même de la décadence. Si G. B. Shaw ou Jaurès privilégièrent chez Wagner la dimension progressiste ou révolutionnaire, l’interprétation inverse fut souvent développée, en bonne (D’Annunzio) ou en mauvaise part, par exemple chez Brecht ou Adorno. Cette double inscription d’un côté ou de l’autre d’une sorte de frontière symbolique est en quelque sorte devenue l’enjeu d’une lutte intellectuelle. Impossible de trancher, puisque l’ambition du Wagner était bien de créer un modèle nouveau tout en enracinant son art dans l’histoire d’une nation. Dès lors, la production lyrique des années 1920 et 1930 conduit à son paroxysme la question de la modernité de l’œuvre wagnérienne : des compositeurs adoptent des positions réactionnaires, d’autres s’enferment dans une esthétique décadente, d’autres encore recherchent la modernité à tout crin. On sait qu’Adorno opposa Schönberg, dont il fit le représentant du progrès, à Stravinsky, symbole de la restauration et du goût pour le mythe.
17C’est dès lors la question de la nature même de la modernité qui se trouve soulevée. Ainsi de l’idée d’œuvre d’art totale si chère à Wagner. Jean‑Luc Nancy et Patrick Lacoue-Labarthe en ont souligné la proximité avec l’esthétisation de la politique dans les régimes totalitaires :
L’opéra […] n’a cessé d’avancer en regardant en arrière. Et le politique de même, qui n’a su en démocratie faire le deuil de cette forme qui la met constamment en danger, ainsi que le prouve le moment du mythe nazi. Wagner est venu actualiser la promesse romantique de la résurrection du grand art, seul susceptible de donner forme, à partir du moment où les modèles grec et chrétien se sont affaissés, à ce besoin pour tout peuple de l’autofictionnement. Mais sa récupération dans la première moitié du xxe siècle a montré le danger ultime de ce processus d’identification. (p. 67)
18Il n’y a pas de pure modernité : celle-ci n’est jamais entièrement dissociable de ce qui en est son envers et l’exemple de l’opéra wagnérien ne fait que souligner un processus de réversibilité qui se répercute très largement et dont les effets les plus visibles peuvent être observés au tournant du xixe et du xxe siècles, à une époque où les oppositions entre progrès et décadence, entre attente de la Révolution et crise de l’Occident jouèrent à plein.
Pour une histoire littéraire non dogmatique
19L’usage de tels concepts impose, par conséquent, une certaine prudence. Cela d’autant plus que les arrière-gardes sont loin de se confondre avec la cohorte de tous les oubliés de l’histoire littéraire, ainsi que le montrait plus particulièrement l’intervention d’Antoine Compagnon : « L’arrière-garde de Péguy à Paulhan et Barthes ». Prenant pour point de départ une citation extraite de Notre jeunesse (« Ce que nous savons, ce que nous voyons, ce que nous connaissons de toute certitude, c’est que pour l’instant nous sommes l’arrière-garde », p. 94), A. Compagnon poursuit une réflexion issue des Cinq paradoxes de la modernité (réflexion qui remonte peut‑être, en réalité, à La Troisième République des lettres) et esquisse une analyse de la tradition antimoderniste. Le principal représentant de cette tradition n’est autre que Péguy, pour qui la dégradation de la mystique en politique prit une forme temporelle — à savoir le sentiment d’être situé dans un interrègne, une sorte d’entre-deux, « entre les générations qui ont la mystique républicaine et celles qui ne l’ont pas » :
L’arrière-garde, c’est donc l’avant-garde restée fidèle à la mystique que les contemporains ont désertée. La notion témoigne de ce que la pensée allemande de l’entre-deux-guerres devait appeler la « simultanéité des non-contemporains », « hétérochronie » résultant de la divergence du temps et de l’âge, Gleichzeitigkeit et Gleichaltrigkeit, ou de la coexistence des générations, avec les distorsions et disproportions qui en résultent à tout moment dans le mouvement politique et littéraire. (p. 95)
20Un concept désigne parfaitement cette position, c’est celui de « vétéran ». La violence critique dont Péguy faisait preuve à l’égard de l’évolution contemporaine serait le contrecoup d’une anxiété due à la dégradation d’un idéal dont il avait été l’un des hérauts. Manière de montrer que Péguy était moins l’opposant de la modernité que sa « mauvaise conscience » (p. 96), la dénonciation de ce que cet idéal avait de plus naïf (croire qu’il suffit de venir après pour dépasser). Il y a là un rapport à la modernité indissociable de son histoire : dans Les Cinq paradoxes de la modernité, A. Compagnon rappelait déjà l’équivocité de la modernité baudelairienne, quête d’actualité esthétique, mais réaction violente contre la modernisation sociale et la révolution industrielle, refus du passé mais dégoût de la manie de l’innovation et de la rupture — « Le paradoxe de la modernité esthétique est que la passion du présent à laquelle elle s’identifie doive aussi s’entendre comme un calvaire. »
21Deux autres figures permettent de montrer que de Péguy (en réalité de Baudelaire) jusqu’à la fin des années soixante-dix, la même posture fut adoptée par des auteurs extrêmement différents, mais qu’on ne saurait accuser d’avoir rejoint l’arrière-garde par ignorance, par compromission ou par facilité : Jean Paulhan et Roland Barthes. Les Fleurs de Tarbes ou la terreur dans les lettres ne sont peut‑être pas autre chose qu’une analyse, particulièrement subtile, de cette lutte entre avant et arrière‑gardes, dont la littérature serait le champ de bataille. Ancien terroriste devenu, par déception, l’observateur attentif des faits de langue, Paulhan s’employait à pacifier notre rapport aux mots et à retrouver cette confiance critique qu’autorisait autrefois la rhétorique, mais dont nous sommes à présent privés par excès de méfiance (conséquence d’une trop grande exigence à l’égard des pouvoirs du langage) :
Les Mainteneurs – non les réactionnaires, les académiques, les conservateurs, les néoclassiques, car Paulhan invente un néologisme pour marquer, s’il se peut, la différence – sont d’anciens Terroristes reconduits à l’amour de la langue. (p. 98)
22Mais c’est chez Barthes que la posture d’arrière‑garde (A. Compagnon cite un entretien de 1971 : « ma propre proposition théorique […] est d’être à l’arrière-garde de l’avant-garde ») nous intéresse le plus directement, en raison de l’exemplarité que nous en sommes venus à attribuer à son parcours, aussi bien parce son œuvre représente l’une des formes d’avant-garde critique les plus subtiles que parce qu’elle en offre aussi, dans sa dernière étape, un dépassement possible. « Comment passer de la dénonciation du fascisme de la langue à l’indifférence à l’avant‑garde ? » Par la rhétorique, envisagée comme une manière d’aimer encore ce qui est mort, ce qui est en passe de mourir, et de « le retenir encore un moment en ce monde, sans illusions, comme Chateaubriand la monarchie, quand il s’écriait en 1816 : ”Vive le roi quand même !” » (p. 100).
23Dans le dernier cours qu’il fit au Collège de France en février 1980, Barthes cita Verdi, qui disait en 1870 : « Tournons-nous vers le passé, ce sera un progrès. » Certes la spirale, qui fait revenir le même, mais « à une autre place » — éternelle excuse des arrière‑gardes —, lui servait une fois de plus à dénier que son attitude ait coïncidé avec le conservatisme d’un « nouveau réactionnaire », comme on dit en 2003, mais son adhésion à l’arrière-garde — à ce qu’il nommait l’arrière‑garde — était devenue évidente, « car l’avant-garde peut se tromper » : telles furent ses ultima verba (p. 100).
Y a-t-il un classicisme du xxe siècle ?
24D’autres articles reviennent sur la très grande complexité de certaines périodes de notre histoire, trop souvent envisagée d’une manière unilatérale. W. Marx note lui‑même très justement que la tradition ou le classicisme font partie de la panoplie moderniste, notamment dans le monde anglo-saxon (Eliot — « classiciste en littérature, royaliste en politique, et anglo-catholique en religion » — en est le meilleur exemple, et Niels Buch-Jepsen s’attache aussi à le montrer dans le cas de F. R. Leavis, auteur de The Great Tradition), mais également en France chez un auteur comme Valéry. On voit bien que tenter de classer Valéry d’un côté ou de l’autre d’une telle ligne de démarcation n’aurait aucun sens. Impasse que W. Marx convertit en une sorte de fable critique en constatant que « personne n’est plus avant-gardiste que le personnage borgésien de Pierre Ménard, dont le projet de recréer mot pour mot Don Quichotte en plein xxe siècle aurait semblé a priori incarner si bien l’arrière‑garde ». Néoclassique, l’œuvre de Valéry n’en fut de même pas moins une source essentielle pour la théorie littéraire.
25Michel Décaudin souligne lui aussi dans son article, « Avant-garde politique, arrière-garde poétique », l’importance du moment 1910, qui vit la multiplication des groupes « néo » :
Néoclassiques, néoromantiques, néosymbolistes, même néonaturistes… Ces appellations sont un aveu : on veut être dans le mouvement, faire un nouveau, mais on se réclame de théories anciennes. (p. 104)
26Un tel diagnostic ne se limite pas à l’avant-guerre. L’œuvre de bien des écrivains pourrait être envisagée sous cet angle : outre Valéry, quelle place faisons-nous au classicisme de Cocteau, de Mauriac, de Gracq, de Green ou de Yourcenar ? Bien sûr, il n’y aurait aucun sens à prétendre que l’un ou l’autre de ces auteurs souffre d’être ignoré ou délaissé en raison de ses positions esthétiques. Il n’en reste pas moins que plusieurs d’entre eux, notamment Gracq et Yourcenar, ne bénéficient peut‑être pas tout à fait de la reconnaissance qu’ils mériteraient : la facture traditionnelle de leurs textes semble avoir limité leur influence. Leur place relativement secondaire dans les histoires littéraires n’est-elle due qu’à leur désengagement et leur éloignement du champ littéraire ? Ne peut‑on plutôt juger que leur image d’orfèvres de la langue a conduit à leur conférer un statut secondaire en regard d’autres œuvres jugées plus centrales, plus représentatives de ce que nous attendons d’un écrivain ?
27Il y va de la manière dont nous envisageons tout ce qui touche à la continuité d’une tradition. Le problème est particulièrement complexe. Il convient, en effet, de considérer tout d’abord la dimension la plus politique. Sur ce point, l’étude de M. Décaudin se révèle particulièrement intéressante : on y constate qu’une revue comme L’Effort libre (où publièrent Jouve, Durtain, Jablonski…), bien que s’étant voulue d’avant‑garde en matière politique, n’a donné naissance qu’à une littérature lyrico-élégiaque qui ne reflétait en rien les positions prolétariennes mises en avant. Il s’agit donc de prendre en compte d’autres facteurs, ainsi que le fait Régine Pietra en prenant pour objet de réflexion le cas de Julien Benda, particulièrement intéressant, puisque l’auteur de La France byzantine illustre, aussi bien par ses prises de positions intellectuelles, que par son œuvre d’essayiste ou sa pratique de la langue, une pensée de la tradition qui lui confère une forme d’exemplarité. Avec Julien Benda, nous tenons ce qu’A. Compagnon nomme le « modèle du puer senex, du “jeune vieux” qui n’a jamais été contemporain de son âge, qui n’a jamais fini de ressasser son ressentiment contre les modernes » (p. 97). Modèle en quelque sorte du réactionnaire, mais qu’on se saurait pour cette raison rejeter dans les limbes de notre histoire : ce dreyfusard exemplaire n’ignora pas son siècle et beaucoup de ses luttes semblent retrouver de nos jours une certaine actualité – critique de l’alexandrinisme, refus du dévoiement de la littérature au profit de la politique ou défense d’une littérature d’idées dont les exigences de précision et de rigueur ne sont aucunement incompatible avec le travail du style. Il aurait été intéressant, de ce point de vue, d’étudier de manière plus précise l’écriture de Benda, qu’on aurait tort de réduire à une pure recherche d’intransitivité. Aussi nous paraît-il peu convaincant de juger que Benda « peut être considéré comme d’arrière-garde non pas parce ce qu’il défend est mort ou dépassé, mais par la manière dogmatique, exclusive ou, comme on dirait aujourd’hui, psychorigide qu’il a de le défendre » (p. 154). S’il est vrai que Benda s’enferme souvent dans une vision étroite de la littérature, il n’en apporte pas moins une contribution essentielle au développement du genre de l’essai au xxe siècle. À ce titre, il semble que ses partis pris quelque peu intolérants peuvent être envisagés comme des aspects secondaires d’une réflexion plus centrale sur l’exercice du langage et la fonction des clercs.
28In fine, ce qui isole peut‑être aujourd’hui le plus Julien Benda, c’est son mépris du temps présent et sa défense de valeurs jugées universelles. Nous touchons peut‑être là l’un des facteurs essentiels de la réflexion sur les arrière‑gardes. Deux caractéristiques conduisent, en effet, à qualifier ainsi certains auteurs, certains groupes ou certaines périodes. La première touche aux questions politiques : c’est le cas des articles de M. Décaudin, sur L’Effort libre, mais aussi de Martin Puchner sur Wyndham Lewis, de Frank Jouffre sur un éditeur régionaliste proche de l’Action française ou encore de Pascal Mercier dont l’article sur la revue Les Guèpes est tout à fait passionnant (l’auteur y montre que les auteurs de cette revue légitimiste défendent ce qu’ils jugent être une modernité politique, étonnamment compatible avec une certaine indépendance critique : « À l’époque, on situait ce groupe à l’avant-garde de l’Action française, ce qui voudrait donc dire “à l’avant-garde de l’arrière-garde” », p. 128).
29Mais il est une seconde caractéristique, quelque peu différente, et qui touche, cette fois-ci, plus directement à la question de la tradition. Celle‑ci nous semble moins bien représentée, même si les articles d’A. Compagnon, de J.‑Fr. Louette ou de R. Pietra contribuent à y répondre. W. Marx rappelait dans son introduction que dans La Pensée du roman, Thomas Pavel déplorait l’absence de réflexion sur les phénomènes de rémanence et de continuité en histoire littéraire. C’est là, nous semble‑t‑il, l’une des principales voies de renouvellement de l’histoire littéraire : prendre en compte l’existence de traditions ayant valeur d’une sorte de temps long des lettres où le système des genres, l’exercice du style ou les valeurs esthétiques défendues se perpétuent (ou prétendent se perpétuer) de manière quasi-immuable — tout du moins en s’adaptant continuellement aux cadres de réception contemporains. Il s’agit en quelque sorte d’un second régime de littérarité, souvent ignoré des histoires de la littérature, généralement délaissé parce qu’on y obéit à un rythme lent, qu’on y mêle œuvres reconnues et production de masse et qu’on y exploite des modèles fixes et éternellement renouvelables (écritures de soi, art de l’éloquence, littérature scientifique, genre de l’essai, etc.)5. Dans ce cadre, bien des écrivains qui exercèrent parfois en leur temps une véritable magistrature, trouveraient à nouveau leur place : France, Barrès, Bernstein, Bordeaux, Romains… Des auteurs comme Mauriac, Gracq ou Yourcenar pourraient, de même, être envisagés dans la perspective plus large d’une conception traditionnelle de la littérature, envisagée moins sous un angle esthético-politique qu’en tant qu’œuvres relevant d’un désir d’inscription dans un temps long de la littérature.
***
30L’étude de Michel Décaudin sur la revue L’Effort s’ouvre sur la remarque suivante : « L’objet du présent ouvrage est à la fois logique et pervers. » (p. 103). Peut‑être pourrait‑on parler d’un objet nécessaire plutôt que « logique » : la question des arrière‑gardes représente, en effet, un impensé de nos recherches. Quant à « pervers », l’adjectif décrit bien le caractère relativement insaisissable d’une telle notion, dont la complexité est liée à l’histoire même de la modernité. Baudelaire déjà se moquait de la tendance grégaire des Français et de l’importance prise par les métaphores militaires dans le monde des lettres :
Les poètes de combat. Les littérateurs d’avant-garde. Ces habitudes de métaphores militaires dénotent des esprits, non pas militants, mais faits pour la discipline, c'est-à-dire pour la conformité, des esprits nés domestiques, des esprits belges, qui ne peuvent penser qu’en société. (p. 10)
31Nous n’en avons pas fini avec des telles métaphores. La notion d’arrière-garde est une manière d’en explorer les présupposés, à condition de ne pas la réduire à n’être que l’envers systématique d’une notion jugée plus complète et de lui donner un champ d’application qui lui soit propre.

